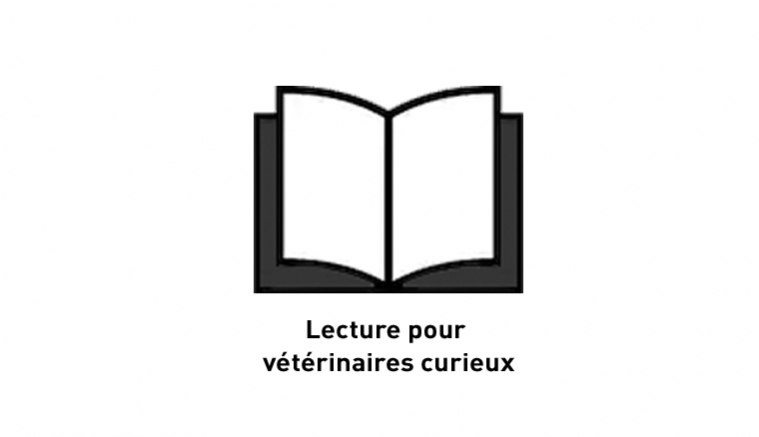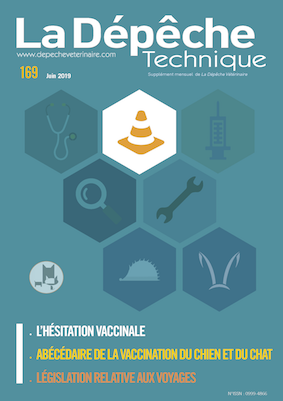LA GRANDE TUEUSE - Comment la grippe espagnole a changé le monde
Thierry JOURDAN, docteur vétérinaire
La pandémie de la grippe espagnole fit entre 50 et 100 millions de morts, soit entre trois et six fois plus que la première guerre mondiale. En comparaison de la tuberculose, la grippe espagnole est une grande absente chez les artistes de l'époque. La maladie n'est pas non plus traitée dans les médias ; parce que le premier ministre espagnol est touché en Aout 1918 et que la censure est moins présente en Espagne, la presse relate la première des trois vagues d'une pandémie qui sera nommée espagnole. Le premier malade connu est un cuisinier d'un camp du Kansas où se croisent des soldats américains qui voyageront ensuite par bateaux partout dans le monde.
Les scientifiques ne connaissent pas encore les virus, et les mesures prises par les autorités sont souvent contreproductives en termes épidémiologiques.
La grippe est vécue par l'opinion comme un châtiment de Dieu comportant des symptômes respiratoires, cutanés et neurologiques épouvantables avec une durée d'incubation très courte.
Face à un tel cataclysme, les remèdes sont nombreux et inefficaces : aspirine, quinine, arsenic, camphre, huile de ricin, dérivés d'iode, alcool, cigarettes, mercure ou saignées sont essayés sans succès.
Les recherches pour connaître l'agent infectieux aboutissent à l'institut Pasteur mais aussi chez les allemands, japonais ou britanniques : l'agent est plus petit qu'une bactérie et est transmissible par injection. Les recherches vétérinaires sur les porcs et les oiseaux permettent dans les années 30 des avancées sur la filtration du virus, sa mise en culture, les variétés, les anticorps et les premiers vaccins. La visualisation du virus aura lieu en 1943 avec l'apparition du microscope électronique.
Ce virus à ARN entre dans les cellules avec un antigène appelé hémagglutinine et en sort avec une neuraminidase. Chaque année 2 % des aminoacides sont remplacés.
L'auteur relate les conditions dans lesquelles le séquençage du virus eut lieu dans les années 90. H1N1 est aujourd'hui conservé à Atlanta dans un laboratoire P4.
L'enquête du patient zéro aboutit à trois hypothèses, une américaine, une chinoise, une française.
Cette pandémie dont la létalité fut de 2,5 % de la population mondiale est née d'une zoonose avec un virus aviaire passant d'un canard à des concentrations de volailles puis vers une population humaine concentrée et mobile. Une nouvelle pandémie est inévitable. Les virus H5N1 et H7N9 sont particulièrement surveillés. La CDC et l'OMC ont identifié des personnes plus à risque suivant leur profil génétique, personnes qui constituent des sentinelles.
Les vétérinaires ont aussi toute leur place dans l'épidémio-surveillance et on rappellera toute l'importance de la vaccination et de son acceptation sociale.
Cet ouvrage particulièrement rigoureux aborde toutes les dimensions sociales, culturelles, politiques, géographiques, médicales et scientifiques de cet événement mondial et traumatique.