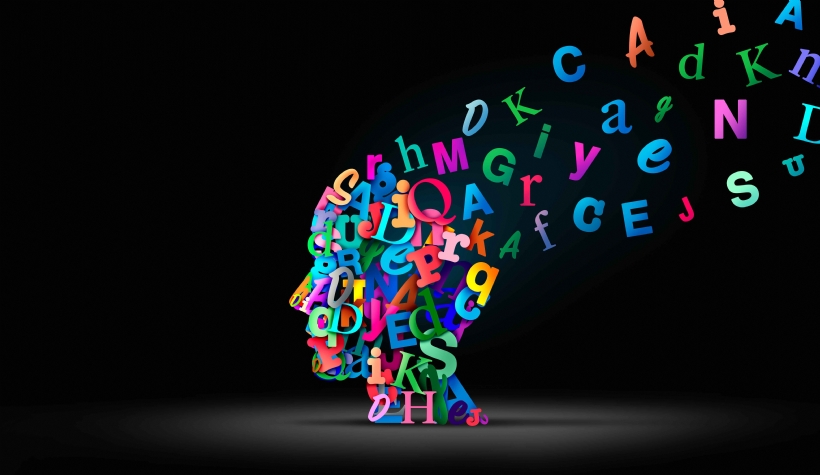Vocabulaire médical : pour l'élégance verbale et contre l'appauvrissement sémantique et terminologique
Mercredi 9 Avril 2025 Vie de la profession 52733Le mot juste et adapté doit être préféré de façon à être précis et juste dans l'approche diagnostique du clinicien, qu'il s'agisse de mots pour décrire une situation, qu'il s'agisse surtout des termes utilisés en sémiologie.
© Freshidea - Adobe
Jean-Luc CADORÉ
Professeur émérite
Médecine interne (animaux de compagnie, équidés)
Agrégé des écoles vétérinaires, dipl ECVIM(CA)
Membre de l'Académie vétérinaire de France
Tribune libre
Appréciant le mot juste et précis dans le vocabulaire médical et souhaitant transmettre sur ce sujet un certain nombre de points de vue, ne serait-ce que pour homogénéiser et améliorer le vocabulaire médical utilisé dans les présentations orales et dans les publications écrites, notre confrère le Pr Jean-Luc Cadoré publie ce petit manifeste pour maintenir la richesse et le bon usage du beau et élégant vocabulaire médical.
Les mots existent pour écrire de belles phrases et donc pour permettre à tous de parler, de lire et de communiquer de la meilleure façon...
Il suffit d'ouvrir quelques ouvrages de presse en langue française pour trouver des utilisations erronées et fâcheuses de beaucoup de mots ou expressions médicaux.
En dresser un florilège autorise une sorte de divertissement terminologique pour reprendre la formule de M. Lescure.
Au-delà, il ne semble pas que ces libertés parfois peu réfléchies en terminologie, pour divertissantes qu'elles pourraient éventuellement être - formule également empruntée à M. Lescure - soient de nature à faciliter l'apprentissage des étudiants et une bonne communication entre professionnels et avec les propriétaires d'animaux tant il est certain que derrière le mésusage de mots, ce sont parfois des concepts qui sont changés, changeants et/ou imprécis.
De plus, certains conférenciers ou rédacteurs, probablement au nom de cette liberté́ loin d'être académique, font parfois appel à un vocabulaire, des expressions et une syntaxe que l'instituteur et le professeur de collège et de lycée et les encadrants de l'enseignement supérieur devraient avoir tout fait pour leur non usage dans la formation des apprenants, avec également une tendance grandissante à l'utilisation de l'apocope, des sigles et des acronymes.
Enfin, cerise sur le gâteau, nous sommes souvent, comme dans la vie de tous les jours, assaillis de tics de langage classiques, mais aussi spécifiques au monde médical (on est sur, au niveau de, du coup... ).
Ainsi la phrase de Camus tombe à point nommé : « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».
La rédaction de l'observation clinique (qui faisait, autrefois, partie de l'examen clinique et qui est encore la façon de communiquer entre confrères et avec les propriétaires ou détenteurs des animaux examinés), la rédaction de cas cliniques, la rédaction d'articles pédagogiques, la présentation des animaux hospitalisés semblent aujourd'hui assez éloignées de la rigueur lexicale et grammaticale d'autrefois au détriment du vocabulaire médical lui-même, au détriment aussi de la précision et de la justesse des observations et, partant, du diagnostic et du pronostic, bref au détriment de la rigueur médicale.
J'entends déjà les commentaires que notre langue est une langue vivante et qu'il faut admettre quelques évolutions ; certes mais ce n'est pas en parlant franglais, non plus en ne respectant plus l'étymologie, ni en utilisant des formulations pour des mots aux confins d'un certain snobisme médical digne de séries télévisées...
Autrefois, nous connaissions l'exercice de version latine. Je vous propose ici une version française d'une observation clinique assez fréquente.
En animaux de compagnie : « Un patient canin gériatrique est référé pour mauvais état général. L'examen clinique révèle une tempé de 38,5° C donc normotherme, augmentation de volume des ganglions lymphatiques, notamment les rétromandibulaires, des muqueuses discrètement congestives, un rythme cardiaque de 160 bpm donc tachycarde, une fréquence respi de 30 mpm, une dyspnée restrictive, un abdomen distendu ; il est ambulatoire, bien que douloureux, et dans un état de vigilance correct quoiqu'assez agité. On le sédate pour réaliser une écho abdo (après avoir réalisé une A, T, P, C POCUS pour point of care ultrasonography alias échographie clinique ciblée ou échoscopie et avoir éventuellement vu des lignes B, des « shred lines... ») et une bioch est demandée ainsi qu'une num ; son analyse d'urines révèle une densité de 1003 et une protéinurie très sévère avec un RPCU explosé de 25. L'ensemble des signes cliniques et des examens complémentaires (l'écho abdo révélait la présence de stéatite périorganique, d'un épanchement périrénal rétropéritonéal, une dilatation pyélique et une jonction cortico-médullaire affirmant une néphrite chronique ainsi que des images d'hépto-pancréatopathie et de gastro-duodéno-jéjuno-iléo-colopathie) font que ce chien est diagnostiqué syndrome néphrotique scoré au max, dont la physio-pathogénie est incertaine tout comme ses étiologies possibles. Cette pathologie justifie ainsi une fluidothérapie avec une CRI de saline qui sera accompagnée de la distribution d'un aliment rénal. Évidemment il sera également mis sous antibio et cortico sans avoir eu besoin de demander une bactério ni une cytologie urinaire. »
En équine, lors d'une « ronde » (entendre visite des hôpitaux), en faisant un clin d'oeil à la promotion d'internes qui reconnaîtra le texte (!) :
« La colique avait des muqueuses congestives, un cardiaque et une fréquence respi super élevés ; alors elle est passée en chir, on l'a scrubé et on l'a ouvert : on a trouvé un entrappement néphrospénique et une impaction. Après sa chir, on l'a mis sous perf, on a flushé le KT, on l'a marché activement et on a fait des HT/Pt/Lactates aux 4 heures. Elle avait les trigly explosées donc on l'a mis sous glucose et insulinothérapé ; Le lendemain on l'a dessondée, elle a eu un épistaxis et on a pratiqué une endo. Elle a recoliqué, on l'a sédatée et on a mis un coup d'écho flash/POCUS. »
D'autres exemples pourraient être également cités pour illuster le mésusage et la confusion : pathologies (et même si son utilisation au quotidien a considérablement évolué, nous sommes loin de dire que le cardiologue soigne les cardiologies ! ), symptômes neurologiques, examen ophtalmologique, syndrome urologique félin, syndrome brachycéphale, asthme félin du chat, asthme équin du cheval, syndrome métabolique équin du cheval, la maladie rénale chronique, suber (prononcer « se ») pour décrire la mise en place d'un dispositif de dérivation pyélovésicale, taxiser pour exercer une pression vésicale pour obtenir une miction, splascher pour l'application d'anesthésique local, faire des puffs, stenter, flusher pour rincer un cathéter, arthrite de l'articulation, phlébite de la veine, dermatose cutanée, infection par la leucose féline, urolithiase pour urolithe...
Le mot juste et adapté doit être préféré de façon à être précis et juste dans l'approche diagnostique du clinicien, qu'il s'agisse de mots pour décrire une situation, qu'il s'agisse surtout des termes utilisés en sémiologie.
Il me semble important de maintenir cette culture médicale dont il convient de rappeler qu'elle trouve ses racines dans les différentes écoles de grands médecins et vétérinaires français, tout comme d'ailleurs la sémiologie et qu'il n'est pas utile de franciser des termes anglais impropres. Même les auteurs anglo-saxons s'émeuvent désormais du mauvais usage de certains de leurs mots que certains parmi nous utilisons pourtant de façon erronée : par exemple permissif, non remarquable ; d'autres appellent aussi à l'utilisation du mot juste en anglais tandis que nous autres pensons qu'on peut tout utiliser de cette langue qui est aussi belle dans sa précision que la nôtre.
Ne détenant évidemment aucune vérité, je me suis toujours astreint à respecter ce que mes maîtres m'ont appris, tenant compte que notre langue est vivante et doit aussi évoluer. Il me semble donc absolument nécessaire de maintenir en respect ce charabia médical envahissant qui d'ailleurs en conforte plus d'un dans une espèce de monde où les animaux malades deviennent comme les patients à l'hôpital, de simples numéros pour lesquels seule une approche de techno-sciences instrumentalisée est proposée sans réel colloque singulier...
À l'heure de la littératie et du développement opportun de la médecine narrative, des espaces pour l'apprentissage partagé de sémantique médicale, la lecture de dictionnaires du vocabulaire médical, un travail plus important des Académies pour rendre des avis argumentés doivent être développés et favorisés par les facultés et écoles vétérinaires au risque d'assister à une paupérisation de la médecine et à sa banalisation, mettant au même rang cet art et cette science que des disciplines strictement techniques certes importantes mais incomparables avec notre approche médicale.
Et même si, pour compléter la phrase de Camus dont on ne sait réellement s'il en est l'auteur, « ne pas les nommer c'est nier l'humanité », il me semble donc nécessaire de revoir et d'harmoniser le vocabulaire utilisé et la façon dont il est utilisé dans tous les exercices d'enseignements et dans toutes les matières afin, par exemple, de ne pas faire le grand écart entre syndrome brachycéphale et les obstructions des premières voies respiratoires et affections associées des brachycéphales !
Le parler juste médical est donc un véritable enjeu pour nos écoles, pour nos associations professionnelles, pour nos revues professionnelles et pour notre profession. ■
L'auteur de cette tribune a rédigé un glossaire qui est disponible en ligne sur notre site Internet.
Lectures complémentaires
- Lescure F. Divertissement terminologique ou terminologie divertissante. Éditorial, Coup d'oeil, 1990.
Gros Plan : Les pires expressions et tics de langage : « terminologie divertissante ou divertissement terminologique »*
Du coup, au niveau de, on est sur..., DDX, dégazer (lors de prise en charge chirurgicale de coliques chez le cheval), sulfater (administrer du sulfate de magnésium), taper un cliché, taper la jug, animal diagnostiqué (on diagnostique une maladie chez un animal), tempé (pour température), respi (pour respiratoire), aux quatre heures (toutes les quatre heures), bradycarde, tachycarde, 4 point 5 au lieu de 4 virgule 5, scruber, sédater, suber !, désuber !, taxiser, splascher, grader, scorer, à ce stade, dans un contexte, discrètement, bilatéralement, syndrome brachycéphale, aliment rénal, normotherme, hypertherme, liste des problèmes, référer, étio-pathogénie, physio-pathogénie, puff, CRI, pathologies...
Épanchement pour une lame de liquide libre, stéatite, épanchement péri-rénal... Image de gastro-entéro-colopathie...
Asthme félin du chat, syndrome métabolique équin du cheval, asthme équin du cheval, lipidose (au lieu de stéatose), arthrite de l'articulation, tendinite du tendon, ténosynovite de la bourse, phlébite de la veine, dermatose cutanée...
Patient canin, félin, équin pédiatrique/gériatrique !
Et aussi chir, réa, bioch (pour examen biochimique), iono (pour ionogamme), (ou pire : je lance une bioch et un iono !), échocardio (pour échocardiographie), bupré, étiologies ou encore « la gestion du traitement », « la gestion des signes cliniques », « la gestion du malade »...
Une dernière recommandation : quand on utilise des sigles ou des acronymes (de préférence en français), il faut en connaître précisément la signification... Pr. J-L.C.
* En mémoire de M. le professeur Lescure dans son éditorial dans la revue Coup d'oeil, été 1990.