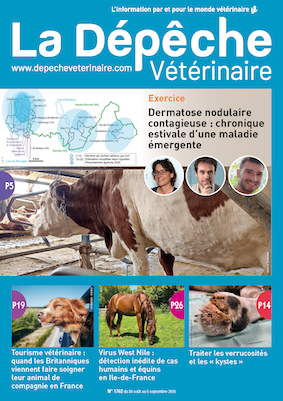Révolution de l'alliance thérapeutique
Samedi 20 Novembre 2021 Anesthésie Douleur 42369© Thierry Poitte
Médecines humaine et vétérinaire partagent le même déficit d'observance dans la prise en charge des DCs en raison du comportement du professionnel de santé (disponibilité insuffisante, objectifs flous, conviction non affichée, attitude dogmatique ou autoritaire, etc.) et du patient ou du propriétaire de l'animal (non adhésion non intentionnelle par oubli, mauvaise lecture, incompréhension, etc.) ou intentionnelle (peur des effets indésirables, dépendance, préjugés, fatalisme, lassitude, manque d'implication, résistance et freins psychologiques, réactance et opposition marquée, échec de la relation avec le soignant, etc.).
L'alliance thérapeutique (AT) et ses changements de paradigme dans la relation soignant - patient/propriétaire peuvent apporter des solutions à ces causes majeures d'impasse thérapeutique et de nomadisme médical.
L'alliance thérapeutique du latin ad ligatere (se lier avec) se définit comme une collaboration active entre le soignant et le patient/propriétaire, basée sur une appréciation partagée des problèmes et un accord sur les solutions possibles 122.
Le prérequis est la recherche d'un équilibre entre savoir recevoir et savoir donner.
SAVOIR RECEVOIR
Dans ce domaine particulièrement subjectif de la douleur, la réussite de l'AT dépend des qualités d'écoute et de l'attitude empathique du praticien (cf. encadré 5).
Ce temps d'écoute dévolu à la médecine narrative amarre un premier ancrage relationnel, révélateur de l'intérêt et des qualités humaines du praticien. Il nécessite un temps de consultation plus long et donc des plages horaires dédiées.
L'écoute est passive, accompagnée d'un langage corporel attentif, suivie d'une écoute active, bienveillante, écartant les questions fermées (aux réponses binaires) pour des questions ouvertes commençant par « comment » et « pourquoi ». Le propriétaire est invité à exprimer ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense et ce qu'il craint pour son animal (« je ne veux pas qu'il souffre »).
L'empathie est un moyen de communication inter-individuelle défini par la capacité de partager et de comprendre les émotions d'autrui. L'empathie, en valorisant la subjectivité de l'expérience de la douleur, devient une attitude thérapeutique déterminante dans l'approche des DCs 123.
SAVOIR DONNER
L'adhésion au projet thérapeutique individualisé et durable repose sur la bonne compréhension du propriétaire.
Savoir expliquer
La qualité de l'information transmise repose sur des critères d'actualité des connaissances et sur des critères pédagogiques soucieux de la bonne compréhension des explications.
Les douleurs chroniques seront définies par comparaison avec les douleurs aiguës : l'image d'un cablage électrique en surchauffe, détérioré par le temps et transmettant un message distordu peut être utilisée.
Les fausses croyances sont écartées : la résignation et le fatalisme qui amènent souvent à l'équation « âge = douleurs », le rôle prétendument néfaste de l'exercice physique, la surestimation des effets indésirables (AINS), de la dépendance (opioïdes) ou des promesses thérapeutiques (cannabis).
La triple Approche Fonctionnelle, Qualitative et Emotionnelle de la Douleur (AFQED) permet de distinguer un handicap fonctionnel tolérable d'une souffrance indicible, incompatible avec le respect de la qualité de vie.
Cette étape évaluative permet d'aborder les spécificités propres à chaque animal douloureux et, par conséquent, la nécessité d'un projet thérapeutique individualisé et durable.
Savoir proposer
Ce projet repose sur les dernières connaissances scientifiques englobant les moyens pharmacologiques, les méthodes non pharmacologiques dites complémentaires et les biothérapies. L'évaluation des rapports bénéfices/risques doit toujours se faire dans la lignée de la médecine factuelle. Celle-ci correspond à une démarche systématique associant à la formulation de la question clinique, une recherche de l'information pertinente, sa lecture critique et enfin son applicabilité à un patient donné avec son histoire douloureuse et ses comorbidités 124.
Ce projet doit s'accompagner d'objectifs pragmatiques et réalistes, partagés avec le propriétaire : un handicap fonctionnel peut être toléré et amendé par des stratégies de coping (terme anglais qui signifie littéralement « faire avec ») basées sur l'adaptation de l'environnement et l'ergothérapie (orthèses). En revanche, une dégradation trop importante de la qualité de vie, à l'origine d'un mal-être permanent inacceptable, doit interroger sur la persistance éthique des soins.
Savoir transmettre
L'éducation thérapeutique consiste à donner des compétences évaluatives (AFQED - CSOM - CBPI) et des compétences de soins : connaissance des techniques de massages, de conduite d'exercices physiques à faible impact, de la balance bénéfices/risques des AINS, des anti-épileptiques ou des psychotropes, des bonnes règles d'administration des médicaments (voie orale, transmucosale, etc.).
L'éducation thérapeutique a la double vertu d'autonomiser le propriétaire et de valoriser ses responsabilités dans la recherche du bien-être de son animal de compagnie.
CONCLUSION
L'alliance thérapeutique est indissociable d'une médecine pro-active de la douleur, basée sur la culture de la médecine préventive d'affections chroniques douloureuses. En lieu et place d'une médecine encore trop souvent dominée par des approches réactives, suite à des accès douloureux paroxystiques ou à une dégradation de l'état de l'animal.
L'approche pro-active implique les compétences reconnues de l'équipe vétérinaire (praticiens et ASV), les compétences en devenir des propriétaires et l'inscription de l'animal douloureux dans un parcours de suivi évaluatif et thérapeutique (cf. encadré 6).
L'alliance thérapeutique s'éloigne ainsi de la tentation simpliste des « recommandations » thérapeutiques, des procédures automatisées et des protocoles normés (arbres décisionnels uniformes) qui ne tiennent pas compte de la complexité des DCs.