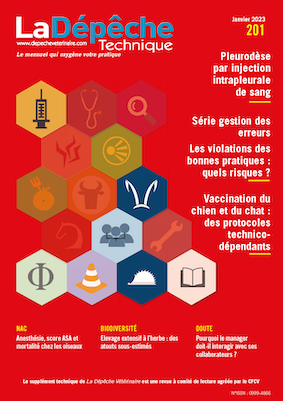Pourquoi le manager doit-il interagir avec ses collaborateurs ?
« Je ne constitue pas autrui, je le rencontre. » Jean-Paul Sartre
Frédy Perez
La relation humaine est au coeur du management en tant qu'elle est parfois une relation hiérarchique, professionnelle, parfois familiale, amicale ou tout à la fois. Qu'il s'agisse de moments programmés comme un entretien ou une réunion ou que le contact se fasse en se croisant, ces rencontres sont essentielles car elles sculptent à la fois la relation et l'individu. L'influence profonde de ces moments d'échanges permettent au collaborateur comme au manager d'être en résonance avec l'entreprise. Ces moments privilégiés peuvent magnifier le travail et plus généralement l'existence. Mais quelles sont les conditions requises pour ces moments d'interaction, d'échange, de rencontre ? Force est de constater que ces moments sont malheureusement souvent atrophiés ou frustrants, décevants ou carrément inexistants. Pourquoi laissent-ils le manager ou le collaborateur sur leur faim ou, à contrario, pourquoi certaines relations professionnelles peuvent-elles marquer favorablement à vie ?
La relation au coeur de la vie professionnelle
Pour Martin Buber 1, philosophe assez méconnu du début du siècle dernier qui pourtant a influencé les illustres Husserl, Sartre, Levinas, Bachelard ou encore Lacan, la relation avec l'autre n'est pas simplement intéressante ou divertissante mais elle est le coeur de la vie humaine. Alors évidemment, il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de-même en entreprise, entre ses différents membres et bien sûr entre les collaborateurs et leur manager. Que ressentent les collaborateurs qui ne peuvent pas entrer en relation avec leur responsable ? Si pour certains, la compensation qui leur permet de s'y retrouver est possible grâce à une riche et intense vie sociale en dehors de l'entreprise, pour d'autres le manque peut être terriblement douloureux.
Qu'attendent les collaborateurs ?
Il est banal d'entendre un constat faisant référence au manque de relations, de rencontres, d'échanges, d'interactions quelles qu'elles soient. De nombreux collaborateurs pensent que l'on ne communique pas assez ou mal dans leur entreprise, « on ne communique pas assez » est prononcé des millions de fois chaque jour dans les entreprises. Mais il ne s'agit pas que d'une frustration, il faut s'arrêter sur ses conséquences : « On ne peut pas aborder tel sujet », « nous nous sommes croisés », « nous n'avons pas eu le temps » ... Les conditions de possibilités des échanges dans l'organisation sont parfois inexistantes et structurelles, parfois culturelles ou psychologiques. Le manager n'est pas en reste de ce constat et peut lui aussi se plaindre de ce manque d'interactions. Mais sommes-nous vraiment certains que tout est mis en oeuvre pour permettre ces échanges ? Quelle puissance l'habitude a-t-elle pour qu'elle mette autant à distance les individus alors que les bénéfices de la relation sont évidents et bien connus ? Quelles certitudes ou quels aprioris bloquent les managers pour ne pas aller vers les autres ? Quelle logique prioritaire l'emporte pour que les entreprises fassent passer les tâches avant les individus ? Quelle bulle est créée pour que tout un monde d'altérité échappe aux coéquipiers d'une entreprise ? Et comble de cette logique de l'autocentrisme de chacun : Ne préférons-nous pas quelquefois consulter notre smartphone, donc sombrer dans une logique d'entre soi plutôt que d'entrer en relation avec l'autre ?
Être prêt au bouleversement
Pourquoi le manager ne sort-il pas (au moins symboliquement) de son bureau ? Serait-il trop accroché à son identité, la représentation de son rôle, son statut ? Selon Sartre 2 : « Ton désir tu ne peux pas savoir quel il est avant de rencontrer l'autre ». Donc, sortir de son bureau autant que le peut le manager, pour découvrir ou redécouvrir un monde et au passage se découvrir dans les interactions avec les autres semble indispensable. Encore faut-il que le manager n'aille pas systématiquement voir ceux qui lui ressemble ou pensent la même chose ! L'obsession de soi empoisonne l'élan vers les autres ; en effet il est impossible de rencontrer l'autre si l'on pense se suffire à soi-même. « Soyez vous-même ! » nous dit-on ou encore « soyez fiers d'être vous-même » ! Résultat, lorsque le manager est trop accroché à son identité, son statut, sa fonction ou son image il n'y a pas de place pour la véritable rencontre de l'autre.
Lorsque le trouble s'invite dans l'échange
Lorsque nous sommes dérangés dans nos certitudes pour devenir curieux de ce qui n'est pas soi, et qu'enfin le trouble s'installe car on a envie de découvrir les pensées de l'autre, on peut parler d'un moment où l'on brise notre « carapace identitaire ». Hegel 3 parle de l'objectivité du changement lorsqu'il avance que, lorsqu'après une rencontre, il n'y a pas d'avant et d'après (mêmes certitudes, mêmes habitudes, mêmes réflexes etc.), ce n'est pas à proprement parler d'une rencontre dont il s'agit mais le simple fait d'avoir croisé quelqu'un. Pire encore, le manager peut vivre parallèlement aux autres : certes la confrontation est évitée mais il est aussi impossible d'établir un contact donc d'entrer en relation. Le manager ne trouve rien, ne voit rien, ne heurte rien, n'approche rien et n'éprouve rien. Et même si cet éventuel télescopage peut sembler désagréable, car il peut faire émerger des désaccords, voire des conflits, c'est à la fois une des missions du management et accessoirement... la vie.
Être prêt à l'inattendu
Mais la difficulté principale ne vient-elle pas du fait que, pour l'essentiel, le manager a une attente ? Il attend toujours quelque chose, sous-entendu il a une approche utilitariste des échanges : des résultats, des comportements, des attitudes, des propositions, des réponses... N'a-t-on pas ici, de fait, fermé toute possibilité d'une rencontre originale car, en général, le manager n'est pas disponible à ce qu'il n'attend pas. Si le manager cependant acceptait le trouble et admettait de ne pas tout maîtriser, il remplacerait ainsi sa volonté active par un mouvement de disponibilité à l'égard de l'inattendu. Toute la difficulté réside dans le fait que lorsque le manager s'adresse à son collaborateur, c'est qu'il a une attente, par conséquent la véritable entrée en relation n'aura lieu que s'il accueille l'inattendu. Face à cette question philosophique difficile, il est possible de proposer l'hypothèse d'un juste milieu en incitant le manager à aller vers les autres en équilibrant « le donner » et « le recevoir » : organiser des échanges et des rencontres, libérer la parole en provoquant la créativité, laisser une place au hasard sans renoncer nécessairement à formuler des demandes ou des exigences.
Initier le mouvement
Que dire alors de ces entretiens formatés et ces (très nombreuses) réunions qui n'obéissent qu'à une logique d'attentes sans laisser la place au véritable dialogue ? Le secret de ces moments ne résiderait-il pas dans l'adoption d'une démarche volontaire de relâchement. Ce qui souvent est nommé « lâcher-prise » pourrait être avantageusement remplacé par une « attitude relâchée », sous-entendant un « je verrai bien ce qu'il advient ». Comment y parvenir ? Prendre ce qui arrive avec son lot de contingences sans écraser d'emblée la relation par un objectif pourrait passer par une capacité de renoncement pour se rendre disponible. La disponibilité est sans doute un des grands perdants du management moderne bien qu'il soit énoncé à tout bout de champ comme une évidence : « il faut être disponible pour son équipe ! ».
Pour un management de la réinvention
Dans quels buts et pour quelles raisons le manager devrait-il accepter ce renoncement positif ? En quoi peut-il être productif ? Peut-on simplement répondre : pour apprendre ! Le manager est-il « fini » dès lors qu'il est nommé à un poste de responsabilité ou qu'il a validé un diplôme de management ? Ce métier, comme sans doute tous les autres, ne serait-il pas plutôt en construction constante ? Le responsable n'a-t-il plus à apprendre, à recevoir, qu'à dicter « son » management ? Et comment pourrais-t-il apprendre s'il n'accepte pas de modifier en permanence sa trajectoire de vie managériale ? Refuser d'être influencé par la réalité qui se déroule chaque jour et qui est source de progrès, c'est se garder de toute influence certes, mais cela implique de ne pas créer de véritable expérience. Toutes les rencontres managériales produisent quelque chose dès lors que l'on cesse de penser que l'on connaît les autres ou que l'on connaît leurs réponses. Faut-il que le manager soit capable de prendre le risque de « se perdre » dans l'autre afin de trouver sa meilleure façon de manager.