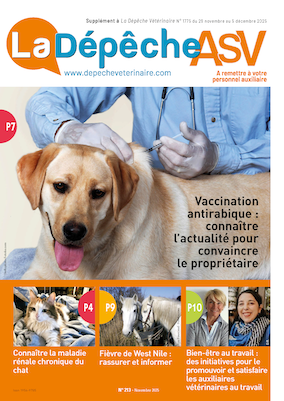Point d'actualité sur la parvovirose canine
© Jacques Girardeau
Pierre BESSIÈRE et Séverine BOULLIER
Les auteurs de cet article déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt avec le sujet traité.
Les gastro-entérites aiguës causées par le parvovirus canin (CPV) sont une cause fréquente et importante de mortalité chez les jeunes chiens, et ce, malgré la vaccination.
Cette dernière est la principale mesure de prévention pour lutter contre les infections symptomatiques. Les vaccins utilisés sont des vaccins vivants atténués modifiés, stimulant les réponses humorale et cellulaire et, induisant une protection intense et durable contre la maladie.
Cependant, l'injection du vaccin ne résulte pas toujours en l'instauration d'une réponse protectrice et, parfois, les animaux vaccinés peuvent quand même déclarer la maladie.
Ces échecs vaccinaux peuvent être dus à plusieurs causes, dont la principale est la présence d'anticorps d'origine maternelle (AOM). Est-il possible d'avoir des vaccins efficaces malgré la présence des AOM ?
UN PARVOVIRUS, C'EST QUOI ?
Les parvovirus appartiennent à la famille des Parvoviridae, elle-même divisée en deux sous-familles : les Parvovirinae, qui infectent de très nombreux hôtes vertébrés (dont l'homme) et les Densovirinae, qui infectent les arthropodes. De très petite taille (autour de 25 nm de diamètre, soit environ quatre fois moins qu'un virus influenza ou un coronavirus), ces virus sont non enveloppés et possèdent un génome à ADN, de courte taille lui aussi (cf. photo 1).
Une de leurs caractéristiques principales est leur étonnante résistance dans l'environnement : lorsque les conditions optimales sont réunies, ils demeurent infectieux pendant des mois, si ce n'est des années. Cette résistance pose problème lorsque vétérinaires et éleveurs doivent nettoyer leurs locaux : un parvovirus tolère des températures élevées et l'exposition à un pH de 3 comme à un pH de 9.
Si tous les virus sont des parasites cellulaires, ceci est particulièrement vrai pour les parvovirus : leur génome étant très limité en taille, ils sont bien plus dépendants de la machinerie cellulaire que d'autres virus. Ainsi, pour se multiplier, la plupart des parvovirus ont impérativement besoin d'une cellule en train de se diviser. La réplication virale a donc lieu dans les cellules au cycle de vie rapide, comme les cellules épithéliales intestinales, les cellules de la moelle osseuse, ou encore, les myocardiocytes. Les cellules infectées finissent par mourir, le virus étant cytopathique, ce qui entraîne l'apparition de signes cliniques.
UN VIRUS, DES VARIANTS
La parvovirose canine est due au parvovirus canin de type 2 (CPV-2) qui a émergé en 1978. Si ses origines sont encore soumises à controverse, la plupart des scientifiques s'accordent sur le fait que CPV-2 est un virus dérivé du parvovirus félin (FPV). Suite à son émergence, CPV-2 diffusa rapidement à la surface du globe et causa une panzootie affectant les chiens de tous âges, aucun animal n'ayant d'immunité pré-existante à l'époque. Le virus fut ainsi nommé pour le différencier d'un autre virus antigénétiquement très différent, alors appelé CPV-1 (ou canine minute virus), responsable de mortalité périnatale, et qui fut plus tard renommé Carnivore bocaparvovirus.
C'est quelques années après son apparition que le CPV-2 donna naissance à son premier variant antigénique (c'est-à-dire un variant suffisamment proche du virus parental pour ne pas donner lieu à la création d'une nouvelle espèce, mais suffisamment différent pour être moins bien reconnu par les anticorps anti-CPV-2) : le variant CPV-2a, dont la protéine de capside VP2 différait de cinq à six acides aminés. Très rapidement, CPV-2a devint majoritaire, car ses mutations lui apportèrent non seulement une meilleure adaptation au chien, mais lui permirent d'infecter les félidés (ainsi que d'autres carnivores). Si le virus originel, CPV-2, dérivait d'un virus félin, il avait perdu la capacité d'infecter ces derniers : l'acquisition des mutations de CPV-2a régla ce problème. Durant les années qui suivirent, deux autres variants furent découverts : CPV-2b, en 1984, puis CPV-2c, en 2000. Ces deux variants ne diffèrent significativement du CPV-2a et entre eux que par un seul acide aminé (plus précisément, l'acide aminé 426 de la protéine VP2).
A l'heure actuelle, ces trois variants circulent, tandis que le virus originel CPV-2 s'est éteint (mais continue d'être présent dans la majorité des formulations vaccinales).
VARIANTS ANTIGÉNIQUES ET PROTECTION CROISÉE
La nature de l'acide aminé en position 426 de la protéine VP2 confère aux variants des propriétés antigéniques différentes. La capacité des anticorps dirigés contre le virus originel CPV-2 à protéger contre les variants est un vieux débat au sein des virologistes.
Les données in vitro et in vivo indiquent que les anticorps anti-CPV-2 sont moins neutralisants vis-à-vis de CPV-2a, CPV-2b et CPV-2c. Certains cas de parvovirose causés par CPV-2c chez des animaux pourtant correctement vaccinés ont été rapportés. Mais, globalement, la majorité des études indiquent que les vaccins utilisant CPV-2 confèrent un excellent degré de protection contre les variants actuels. D'une part, parce que les propriétés neutralisantes des anticorps ne passent pas du tout au rien : des anticorps peuvent être certes moins neutralisants, mais parvenir tout de même à neutraliser le virus s'ils sont présents en quantité suffisante. Et d'autre part, parce que la vaccination n'induit pas qu'une réponse humorale, une réponse cellulaire, faisant intervenir les lymphocytes cytotoxiques, étant également induite.
A QUOI SONT DUS LES ÉCHECS VACCINAUX ?
En 2012, une étude australienne indiquait que 3,3 % des cas de parvovirose avaient lieu chez des animaux adultes qui avaient été correctement primo-vaccinés lorsqu'ils étaient jeunes. Quelles sont les causes qui se cachent derrière ces non-immunisations ?
Un échec vaccinal peut-être dû à un problème lié à l'hôte ou à un problème lié au vaccin.
Cette seconde catégorie inclut les erreurs relatives au stockage, les injections ratées, ou le non-respect des protocoles vaccinaux (principalement, l'absence d'injection).
Parmi les causes dépendant de l'hôte, on trouve l'état de santé (maladies intercurrentes, carences alimentaires), l'âge (l'immuno-sénescence), des facteurs génétiques, qui expliquent certaines prédispositions raciales et enfin, les anticorps d'origine maternelle (AOM).
LA MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE DE PRIMO-VACCINATION EN TROIS INJECTIONS
Comme expliqué précédemment, les vaccins contre la parvovirose sont très efficaces et les déclarations d'échec de vaccination sont très rares, la majorité étant rapportées chez le jeune chien. Une étude rétrospective récente s'est intéressée aux déclarations de pharmacovigilance reçues par l'ANMV (agence nationale du médicament vétérinaire) entre 2013 et 2018. Elle n'a trouvé que 216 déclarations d'échecs vaccinaux, pour environ 36 millions de doses vaccinales contenant la valence P vendues au cours de cette période. 94 % des déclarations envoyées concernaient des chiens n'ayant pas encore reçu leur premier rappel vaccinal contre la parvovirose autour de l'âge d'un an.
La cause principale de cet échec vaccinal est bien identifiée : l'interférence avec les AOM, transmis par le colostrum. Les vaccins disponibles chez le chien sont tous des vaccins vivants. Leur immunogénicité et la mise en place d'une réponse immunitaire protectrice sont directement liées à leur capacité à se répliquer dans l'organisme et à mimer une infection naturelle. Les AOM spécifiques du parvovirus sont des anticorps neutralisants qui bloquent l'entrée du virus dans la cellule et ainsi, nuisent à sa capacité à se répliquer. Les AOM sont protecteurs pour le jeune chiot et sont donc indispensables pendant ses premières semaines de vie, mais ils limitent l'efficacité des vaccins. Le taux d'AOM suffisant pour bloquer la réplication de la souche vaccinale est bien inférieur au taux nécessaire pour conférer une protection clinique. Il existe donc toujours une période où le chiot n'est plus protégé contre la maladie, mais reste réfractaire à la vaccination : c'est la fenêtre de sensibilité (cf. fig. 1).
La deuxième difficulté réside dans la grande variabilité des taux d'AOM en fonction des chiots. Beaucoup de paramètres interviennent : le premier est le niveau d'immunisation de la mère, donc son taux d'anticorps anti-parvovirus, ainsi que la qualité de ces derniers. Le deuxième est la qualité du transfert colostral ; il faut savoir quand et combien de colostrum chaque chiot a bu, la prise de colostrum devant avoir lieu le plus précocement possible, et en quantité suffisante. Ces paramètres peuvent être très différents au sein d'une même portée. La vitesse de disparition des AOM est variable selon les chiens. Elle dépend par exemple de la vitesse de croissance des chiots, mais aussi de la consommation des AOM suite à une éventuelle rencontre avec le parvovirus.
Il n'existe pas d'outils simples et fiables permettant d'évaluer individuellement le taux d'AOM spécifiques du parvovirus et donc, de déterminer la date optimale de vaccination pour chaque chiot. La demi-vie des AOM spécifiques du parvovirus ayant été estimée entre 8 à 13 jours, ils peuvent persister jusqu'à 15 semaines. Des études de population ont permis de définir une fenêtre de vaccination dans laquelle il faut vacciner les chiots contre la maladie. Si certains chiots peuvent répondre à la vaccination dès 8 semaines d'âge, il faut attendre 16 semaines d'âge pour d'autres, afin d'obtenir une bonne réponse vaccinale.
Le parvovirus étant enzootique et particulièrement virulent chez le chiot, il n'est pas envisageable de proposer une vaccination unique pour tous les chiots à 16 semaines d'âge. Un protocole permettant d'assurer une vaccination optimale a donc été proposé par un groupe d'experts internationaux (WSAVA), avec une première vaccination vers 8 semaines d'âge, une deuxième vers 12 semaines et une dernière à 16 semaines (ou au-delà). Ce protocole permet de couvrir toute la période de disparition des AOM en réduisant au maximum la fenêtre de sensibilité liée à un taux d'AOM trop élevé pour permettre la vaccination, mais trop bas pour apporter une protection clinique. Ce protocole doit bien sûr s'adapter en fonction des particularités de chaque animal.
LES VACCINS SURTITRÉS
Pour essayer d'optimiser la vaccination malgré la présence d'AOM, plusieurs stratégies vaccinales ont été proposées.
Des vaccins dits surtitrés sont disponibles pour vacciner les chiots. Ces vaccins contiennent une concentration en particules vaccinales environ 100 fois plus élevée que les vaccins classiques. Le rationnel derrière cette stratégie est de considérer que le taux d'AOM nécessaire pour neutraliser le vaccin sera plus élevé et qu'une proportion plus importante de chiots pourra donc répondre dès les premières injections.
Les résultats des études montrent en effet que ces vaccins surtitrés induisent une séroconversion en présence de taux d'AOM plus élevés que les vaccins conventionnels et réduisent la fenêtre de sensibilité.
Même s'ils sont peu utilisés en routine, ces vaccins peuvent être intéressants pour les premières injections de primo-vaccination quand les concentrations en AOM restent élevées (jusqu'à 12 semaines). En revanche, en l'absence de certitude d'efficacité de ces premières injections, il reste nécessaire de réaliser l'injection à 16 semaines d'âge.
LE VACCIN RECOMBINÉ CPV-2C
Un nouveau vaccin contre la parvovirose vient d'arriver sur le marché : le Nobivac® DP plus. Il s'agit d'un vaccin vivant atténué recombinant. La souche vaccinale CPV-2 154 a été modifiée génétiquement pour exprimer la protéine de capside d'un virus circulant de type CPV-2c. Il s'agit donc d'un virus ayant les caractéristiques d'une souche vaccinale CPV-2, mais exprimant une protéine de capside CPV-2c. L'efficacité vaccinale a été validée par une épreuve virulente réalisée sur des chiots de quatre semaines n'ayant pas d'AOM. Dans cette étude, la protection clinique est observée dès trois jours après la vaccination.
L'intérêt de ce vaccin réside dans le fait qu'il induit une séroconversion même en présence d'AOM à des titres élevés (données EPAR) et qu'il réduit donc la fenêtre de sensibilité. L'étude expérimentale, réalisée sur onze chiots de quatre semaines nés de mères vaccinées, a montré une séroconversion de 100 % des chiots dans les 52 jours qui ont suivi la vaccination. Sept des onze chiots ont montré une séroconversion précoce dès 21 jours post vaccination, les quatre autres ayant répondu plus tardivement. Il est possible que ces chiots aient été vaccinés indirectement et donc, plus tardivement, par les chiots hébergés dans la même enceinte et excréteurs de la souche vaccinale.
Dans une étude terrain, sur 87 chiots de races différentes, âgés de 4 à 6 semaines, 79 (91 %) ont présenté une séroconversion 21 jours après la vaccination (la séroconversion a été définie comme une augmentation de 25 % du titre en anticorps par rapport au titre mesuré à J-3 avant la vaccination).
Ce vaccin semble donc immunogène même en présence d'AOM. Il faut cependant noter que dans les études disponibles, il n'y a pas d'information sur la composition des vaccins utilisées pour les chiennes. Il est très probable qu'elles aient été vaccinées avec un vaccin contenant une souche CPV-2 ou CPV-2b, qui sont les souches vaccinales utilisées dans les vaccins actuellement commercialisés. Il sera important de vérifier si l'immunogénicité de ce vaccin recombinant restera similaire si les reproductrices ont été vaccinées avec un vaccin CPV-2c.
A ce jour, la durée d'immunité induite par ce vaccin n'a pas été évaluée au-delà d'une période de deux mois. Ce vaccin, réservé aux très jeunes chiots à partir de quatre semaines d'âge, est à proposer aussi bien dans les élevages que chez des particuliers. D'après les recommandations du fabriquant et en l'absence de données complémentaires, il est nécessaire de re-vacciner les chiots en suivant un protocole classique à 12 et 16 semaines d'âge. Il faut également noter qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser simultanément avec le vaccin L4.
EPAR: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/nobivac-dp-plus