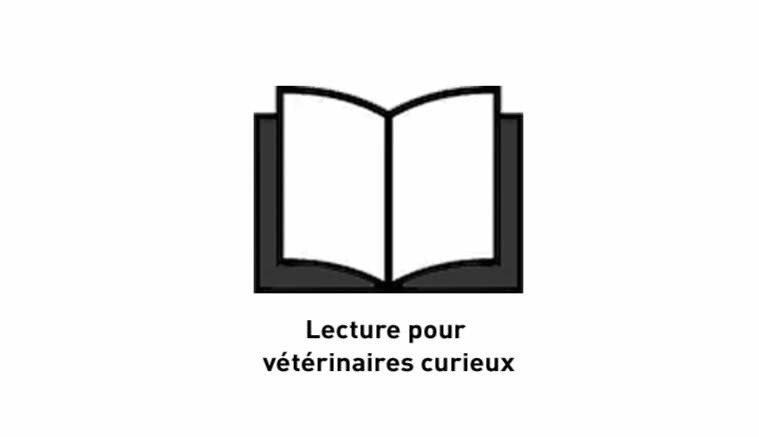Le vétérinaire et la douleur animale
Samedi 20 Novembre 2021 Lecture 42357Professeur Guy Simonnet
Co-auteur du livre :" L'homme douloureux de Guy Simonnet, Bernard Laurent et David Le Breton - Editions Odile Jacob 2019
Bien que la douleur soit très souvent associée initialement à une lésion (nociception), la sensation douloureuse est toujours un reflet complexe, parfois surprenant et déroutant, de l'histoire de vie d'un individu.
La douleur n'est pas le simple reflet d'une lésion. C'est bien ce qu'indique l'IASP* qui définit la douleur comme « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ». C'est donc bien, aussi, tout l'individu, homme ou animal, qui exprime la douleur.
Daniel Le Bars, vétérinaire et directeur de recherche au CNRS**, nous a rappelle justement que : « la douleur ne s'élabore pas au sein d'un cerveau amnésique mais d'un système nerveux central imprégné par son passé, qu'il soit récent ou plus lointain. La mémoire de ce passé concerne l'individu dans son ensemble ainsi que ses relations avec le monde extérieur, mais c'est la mémoire du corps qui constitue le socle sur lequel se bâtit la douleur présente ».
La prise en charge de la douleur ne se limite plus aujourd'hui à la « simple » réduction de celle-ci telle qu'elle se présente factuellement dans le cabinet du vétérinaire. Elle doit désormais également s'assurer que cette douleur « aiguë » ne se transforme pas en douleur chronique, en particulier quand elle est d'origine chirurgicale. C'est donc à un double défi que le vétérinaire se doit de répondre dans sa pratique quotidienne.
Face à l'animal, surtout s'il est « animal de compagnie », le vétérinaire ne doit pas oublier que le soin ne peut se comprendre sans regarder celui qui vit avec l'individu qui souffre. La médecine, qu'elle soit vétérinaire ou humaine, est également affaire de « groupe social » et le couple Homme-Animal en est particulier, à chaque fois original et souvent très riche de ses échanges. On ne peut guérir une douleur chez l'animal sans tenir compte de cette relation parfois étonnante, qu'elle soit positive ou négative. La « contagion émotionnelle de la douleur » entraîne les partenaires de ce couple dans la vulnérabilité, chemin du pathologique, qu'il s'agisse de l'homme ou de l'animal.
Au-delà du médicament que l'on donne à l'animal qui a mal, l'efficacité de tout traitement pourra être amplifiée ou diminuée au regard de ce compagnonnage homme-animal. La médecine relève toujours d'un contrat social que l'on ne saurait oublier lors de l'accueil que le vétérinaire fait à ce couple : l'animal n'est jamais seul en scène.
Dans son « Utopie », Michael Balint (1996) définit ainsi, le médecin dans son exercice : « Notre omnipraticien aura appris que les « maladies cliniques » soigneusement étudiées et classées par la médecine hospitalière ne sont que des épisodes, bien que souvent intensément dramatiques ou même tragiques, dans une longue histoire. Il sait ainsi que chacun de ces épisodes ne représente qu'une des plusieurs « maladies » qu'un patient « offre ou propose » à son médecin. La manière dont le médecin « répond » à ces « offres » a pour conséquence d'orienter l'avenir du patient. L'importance de cette orientation dépasse largement l'éventuelle négligence d'un organique, cet épouvantail effrayant que notre système actuel de formation a si bien réussi à implanter dans l'esprit de tout médecin ».
La médecine vétérinaire, non pas de la douleur, mais de « l'animal douloureux », doit prendre cette réalité en compte sans s'en inquiéter en excès. Toute douleur s'inscrit dans une histoire personnelle, celle de l'individu et de son groupe social. Cette exigence qu'appelle Michael Balint de ses voeux, reste un défi de nos médecines dites modernes, en particulier dans le champ des douleurs qui restent depuis toujours - à travers la plainte - la ligne la plus avancée du langage du « souffrant », animal ou homme. CAPdouleur est un lieu de connaissances (scientifiques) et d'échanges qui devrait nous permettre de mieux poser cette démarche humaniste. Il importe de soigner l'individu en souffrance et non seulement un corps ou une fonction malade.
***Guy Simonnet est Professeur (émérite) des Universités à la Faculté de médecine de Bordeaux, ancien praticien hospitalier et responsable de l'unité UMR CNRS 5287. Ses travaux de recherche ont porté sur les processus de sensibilisation à la douleur, l'hyperalgésie induite par les opioïdes et les mécanismes de la « contagion émotionnelle de la douleur » entre un individu sain et un individu douloureux.
* International Association for the Study of Pain
** Centre national de la recherche scientifique