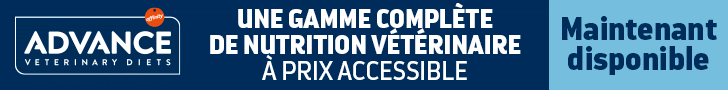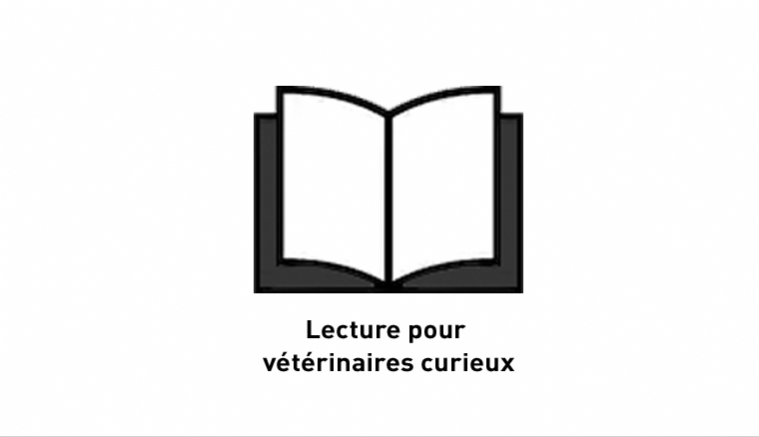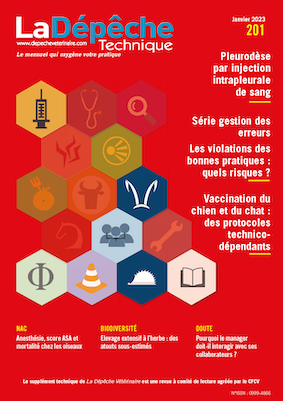L'infini dans un roseau - L'invention des livres dans l'antiquité
Samedi 28 Janvier 2023 Lecture 46686Thierry Jourdan
Les livres n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui, ils ont des pouvoirs, sont dépositaires de savoirs et de mémoires, ont une texture, une odeur.
Irene Vallejo, espagnole de Saragosse, philologue de formation, a publié elle-même des romans, des essais, des livres pour enfants.
Amoureuse des mots, des lettres et de la littérature, elle conte dans cet ouvrage, la naissance des livres et leurs transformations, diffusions, conservations ou destructions.
Le carrefour géographique de ce conte est Alexandrie. Les héros sont souvent inconnus.
Parce que Alexandre rêvait d'un monde de connaissances entre peuples, parce qu'il rêva d'une ville sur une île, parce que son trésor des trésors était Homère et son odyssée, Alexandrie devint le phare du monde antique puis sa bibliothèque.
La mise par écrit de l'Iliade et l'Odyssée nécessita des siècles de conservation et apports oraux par des bardes itinérants. La mise par écrit nécessita un alphabet que les grecs empruntèrent, grâce au génie d'un inconnu vraisemblablement dans le bar d'un port, aux phéniciens. La mise par écrit nécessita un matériau facile à obtenir, à entreposer, à transporter : le papyrus qui, en revanche, ne supportait pas l'humidité, les insectes ou les trop fréquentes manipulations des rouleaux. La mise par écrit nécessita des copistes longuement formés et qui travaillaient à la chaîne.
Longtemps, lire se pratiquait à voix haute et Augustin d'Hippone dans l'antiquité tardive, décrit sa stupéfaction en observant Ambroise de Milan lire en silence.
Entretemps, les romains s'étaient emparés de la culture grecque et nous avons un exemple presque unique de domination militaire d'une civilisation sur une autre vaincue, qui devint dominante culturellement. Les romains ont changé la manière de lire par l'invention du codex. Les élèves romains avaient l'habitude d'écrire sur des tablettes de cire réutilisables et pour conserver leurs connaissances, ces tablettes étaient reliées par des lanières. Le système des pages recto-verso à la file était là.
Les auteurs payaient matière et copistes à défaut d'avoir un mécène pour diffuser leurs écrits à leurs proches ou vers la cité. Philosophes, auteurs de tragédies ou de comédies, poétes ou pamphlétaires perdaient leurs droits d'auteur une fois l'oeuvre diffusée. Les romains avaient la fièvre collectionneuse mais ne lisaient pas : c'était une activité dégradante dont des grecs lettrés mis en esclavage s'acquittaient, en plus de leurs activités de précepteurs, de comptables ou de scribes. Dans le monde romain, libraire ambulant ou résident était un métier aléatoire et difficile. Gare aux diffusions d'ouvrages qui ne plaisaient pas au pouvoir....
Lorsque le parchemin naît à Pergame, le codex remplace avantageusement les rouleaux de papyrus et les couvertures s'ouvragent de plus en plus finement.
La bibliothèque d'Alexandrie a brûlé à trois reprises et tous les lettrés faisaient le voyage dans le Delta du Nil, pour leur recherche ou leur plaisir. Des marchands et militaires sillonnaient le monde pour acquérir tous les ouvrages de tous les peuples connus, les ramenaient et les rendaient rarement, même quand des accords avaient été conclus. Des rouleaux étaient copiés en de multiples exemplaires qui ont été sauvés et conservés dans d'autres bibliothèques publiques ou privées. Nous rencontrons Hypatie comme dernier phare d'Alexandrie et symbole des convulsions des dernières décades du monde romain christianisé et sectaire.
De nombreux autodafés ont eu lieu dans l'histoire et Ray Bradbury en fit une dystopie brutale et nostalgique dans Fahrenheit 451. Les livres ne sont pas éternels comme tout autre support d'information ou de diffusion qui le sont encore moins.
Ils sont en nous, gardons-les précieusement.
Nous croiserons Borges, Strabon, Shakespeare, Socrate, Umberto Eco, Suétone, Italo Calvino, Aristophane de Byzance, Mallarmé, Callimaque de Cyrène, Sappho ou Enheduanna (la Shakespeare de la civilisation sumérienne), Brassens, Démocrite, Lévinas, Périclès, Kapuscinski, Euripide, Cléopatre, Rilke, Ptolémée, Goethe, Tite-Live, Stendhal, Martial, Joyce, César, et un grand nombre d'inconnus qui ont laissé des papyrus ou des fragments de poterie dans les poubelles, ou ont inscrit des graffitis à Pompéi.
C'est un grand et long voyage auquel Irène Vallejo nous convie dans un livre à conserver dans toutes les bonnes bibliothèques.