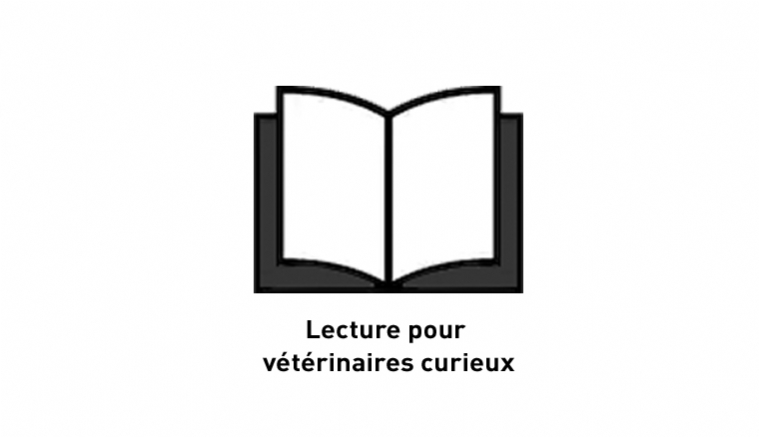Des racines et des gènes : une histoire mondiale de l'agriculture
Samedi 21 Novembre 2020 Lecture 38028Thierry JOURDAN
Nous avons présenté le premier tome dans la DT 180 d'octobre 2020. Voici l'analyse du second tome de cette histoire mondiale de l'agriculture.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, les besoins de reconstruction en alimentation sont largement dépendant des importations. Le machinisme devient une priorité nationale. L'élevage français est, avec la brucellose et la fièvre aphteuse, dans une situation catastrophique. La prophylaxie devient donc indispensable. L'insémination artificielle des bovins se développe, d'abord en Bretagne. Le maïs hybride est adopté et change radicalement l'organisation du travail car il faut acheter les semences, augmenter la mécanisation des champs et vendre à des coopératives toujours plus demandeuses. Le mouvement familial rural regroupe 3000 associations et constitue des supports administratifs, organisationnels, comptables, sociétaux. Les aspirations des ruraux changent.
Les politiques apprennent à dialoguer avec la FNSEA dans un contexte où le crédo est une grande nation industrielle avec une agriculture enfin exportatrice. Le marché commun européen se fixe comme objectif d'augmenter la productivité, d'assurer l'approvisionnement et la sécurité des consommateurs, d'améliorer les conditions de revenus des actifs agricoles. Une politique de prix commun permet d'orienter les productions sans arriver pour autant à correctement réduire les inégalités. L'inflation, les désordres monétaires et les excédents aboutissent à de nombreuses crises même si le niveau de vie des ruraux a beaucoup augmenté.
Dans ce contexte productiviste, la race Holstein ou le maïs deviennent des rouleaux compresseurs. Les prairies naturelles disparaissent, les étangs et marais sont asséchés.
La démocratisation des réfrigérateurs, congélateurs, l'apparition d'aliments longue conservation changent les modes d'approvisionnement au profit des grandes surfaces. Dans le monde, deux humains sur trois ne mangent pas à leur
faim et le productivisme est la solution. La révolution verte s'étend donc au tiers-monde.
Après les trente glorieuses vient le temps des désillusions. L'Europe ne protège plus, elle aliène. Les inégalités augmentent et un éleveur de viande bovine gagne dix fois moins qu'un producteur de porcs hors sol en 1990. Un agriculteur marnais gagne 7 fois plus qu'un agriculteur creusois. La politique du grand large est privilégiée et les zones de grande concentration ainsi que les industries agroalimentaires sont privilégiées. L'agriculture va bien mais pas les agriculteurs !
La réforme de la PAC a lieu en 1992. Les aides en 2005 constituent plus de 50% des revenus des agriculteurs. Les rapports de force sont en faveur de coopératives mastodontes et de la grande distribution : le travail agricole est sous rémunéré.
Le sol est un milieu particulièrement important à préserver mais soumis à rude épreuve par le béton, l'intensivité des productions et les produits chimiques. En 1950, il y avait 2 tonnes de ver de terre par hectare de terre agricole et 100 kilos aujourd'hui. Or les vers de terre ont un rôle de brassage de la terre et de décomposition des végétaux. Ce sol permet aussi de filtrer et purifier l'eau qui atteindra les nappes phréatiques. La culture sans labour est de plus en plus préconisée pour éviter les tassements qui empêchent la terre de respirer.
Il y a 3300 millions d'hectares de terres fertiles dans le monde et chaque année 10 millions sont perdues par dégradation physique, chimique ou biologique. La biodiversité et les services rendus par les pollinisateurs nécessitent des pratiques agricoles adaptées ainsi qu'un respect des habitats de toutes les espèces en danger d'extinction. L'agriculture de subsistance est de plus en plus cruciale pour faire face à des maladies importées ou de nouveaux fléaux. Des conservatoires de diversité sont au nombre de 1400 suivant la FAO et le plus grand est un conservatoire de semences situé au nord de la Norvège dans des bunkers sécurisés.
Les dérèglements climatiques ont des conséquences sur les plantes. Si le gaz carbonique est un dopant végétal, les inondations, sécheresses et vents violents rendent moins prévisibles les rendements. A l'échelon global une nouvelle géographie agricole doit être mise en place. Le stress hydrique et l'accès à l'eau potable pour les populations devront aussi être gérés. Les limites de l'agrochimie avec les nitrates, les algues vertes et les perturbateurs endocriniens sont désormais mieux cernées.
La vision de l'animal d'élevage est aussi en transition vers le bien-être animal (et celui de l'éleveur). Les cohabitations parfois antagonistes entre faune sauvage et pratiques du pastoralisme aboutissent à des frictions locales et sociétales. L'absence de rituels autour de la mort des animaux et les non-dits de l'abattage orientent les consommateurs vers le végétarisme.
Une réponse positive pour les agriculteurs est la qualité qui permet un meilleur partage de la valeur ajoutée : extension des AOC, montée en puissance des produits biologiques, permaculture, services et produits de niches.
La puissance verte des Etats-Unis aboutit à une différence de productivité allant de un à mille avec un paysan africain. Aussi le libre échange ne permet pas une quelconque compétitivité pour ce dernier a fortiori quand il existe des mécanismes protectionnistes en Amérique du Nord et en Europe ainsi que des subventions à l'exportation.
Les biotechnologies permettent de modifier les plantes ainsi que d'accélérer les sélections. Le vivant est désormais breveté. Les plantes peuvent devenir des carburants. Les fruits ou légumes sont de plus en plus brillants et réguliers et surtout se conservent longtemps. Les vaches doivent produire de plus en plus de lait. Le soja OGM est produit dans d'immenses champs en monoculture diminuant les autres cultures de riz ou de de blé, nécessaires à l'alimentation humaine et à la souveraineté des nations.
Mais les oppositions se font jour : des moratoires sont exigés, les craintes citoyennes se généralisent, les risques socio-économiques sont mieux perçus, les stratégies ressemblant à celles de Monsanto deviennent des repoussoirs.
Au lieu de manger du riz OGM enrichi en vitamines une solution plus simple ne serait-elle pas d'ajouter de l'aubergine au riz ? Les OGM sont des outils qui pourraient être pertinents s'ils répondaient aux vrais besoins des consommateurs ou des agriculteurs.
Le défi de l'alimentation reste à la base du métier des agriculteurs entre la malbouffe au Nord et la malnutrition au Sud, alors même que les choses de la terre sont devenues étrangères aux urbains et aux politiques, dans un monde financiarisé et désincarné. Les émeutes de la faim ne sont pas dans notre rétroviseur et les spéculations sur les matières premières, la financiarisation des troupeaux et productions, l'achat de terres fertiles et d'actifs dans des pays africains mettent en danger agriculteurs, citoyens et l'avenir de nombre d'états. Le terme d'expropriation néocoloniale n'est pas exagéré.
La perspective de nourrir dix milliards d'habitants en 2050 revient à au moins doubler la production mondiale et les enjeux sont géostratégiques. Chaque partie du monde joue à un Monopoly avec parfois des dés pipés ou des handicaps de départ.
En France, le modèle « breton » n'a pas d'avenir durable. Il faudra produire et consommer localement, conserver sa souveraineté alimentaire, limiter les gaspillages, redonner du lien entre le paysan et le consommateur qui pourra mettre un visage sur les produits, permettre un commerce équitable, favoriser une agriculture urbaine ou une polyculture diversifiée en débouchés. Pour cela, les connaissances et techniques agronomiques doivent être amplifiées
DES RACINES ET DES GENES : Une histoire mondiale de l'agriculture
Denis Lefèvre Editions Rue de l'échiquier l'Ecopoche - Deux volumes - 2018