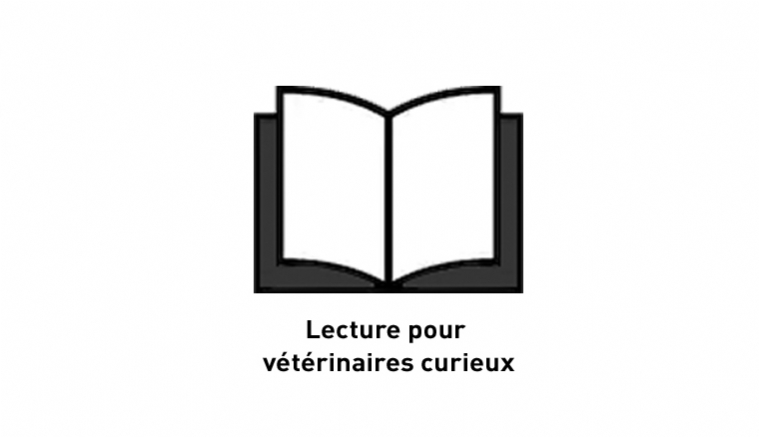Des racines et des gènes - Une histoire mondiale de l'agriculture
Samedi 24 Octobre 2020 Lecture 41749Thierry JOURDAN, docteur vétérinaire
L'auteur (Denis Lefèvre) vient d'une famille d'agriculteurs près de Soissons et ses propres racines l'ont amené en tant que journaliste et écrivain à produire de nombreux ouvrages en rapport avec l'agriculture. Ces deux volumes traitent aux deux tiers de l'agriculture française. Aussi les vétérinaires pourront mieux analyser la co-évolution de leur profession avec celle des agriculteurs, en tirer des enseignements ainsi qu'une meilleure compréhension des actualités. Ils pourront aussi comprendre les limites des modèles dont ils sont les passagers et envisager des futurs viables et durables en tant que vétérinaires et citoyens aux côtés des agriculteurs et éleveurs.
Le premier tome débute au proche Orient en 12 000 ans avant JC, avec les premiers instruments permettant de travailler et de conserver les céréales, dont l'engrain sauvage. 2 500 ans plus tard, dans le croissant fertile, la sédentarité se généralise et l'orge, divers blés puis le froment, le pois, les lentilles sont domestiqués. L'élevage de chèvres et de mouflons (qui deviendront moutons), d'un petit boeuf des tourbières et des aurochs se généralisent entre - 8 500 et - 7 500. En Chine, le riz et le millet, chez les papous, le taro, en Amérique, le maïs, la courge et le haricot, en Afrique, le mil et le Sorgho. Déboisements et premiers ouvrages hydrauliques permettent une augmentation d'échelle des productions. Blé, Maïs et Riz s'étendent sur la planète et impliquent un gros travail soumis aux aléas climatiques. De nombreuses civilisations nomades cohabitent avec les agriculteurs sédentaires. Les écrits agronomiques sont nombreux émanant d'auteurs célèbres. Les gaulois sont d'excellents agriculteurs et éleveurs de moutons et de porcs. Par l'excellence de leur organisation des territoires, les paysages seront façonnés par les romains. La viticulture se développe. Le système féodal est celui du perfectionnement des outillages et pratiques agricoles. L'apport des agronomes andalous et de la civilisation arabe est très important. Les compétences se multiplient grâce aux bénédictins et aux cisterciens. Les foires et marchés apparaissent. Les paysans se rebellent partout en Europe, jacqueries et révolte contre la gabelle en sont des exemples. L'exploration du monde par voie maritime ou terrestre donne une nouvelle géographie alimentaire. Une agriculture plus scientifique se développe au XVIe siècle et l'approvisionnement en chevaux de qualité devient stratégique. Le siècle des lumières éclaire aussi les sciences du vivant puis l'agriculture prend toute sa part dans l'économie.
Parce que certains pays ont une faible surface agricole, de nouvelles méthodes améliorent les rendements et les Flandres ou l'Angleterre entament une révolution agricole et ainsi, les besoins de main d'oeuvre diminuent. Les bergeries et les potagers acquièrent une importance considérable. En France, ce sera la bergerie nationale de Rambouillet, l'aventure des Mérinos et le début de sélections rigoureuses. Parce que les troupeaux sont victimes de maladies contagieuses et que les maréchaux ferrants sont incapables de lutter contre ces fléaux, avec un art vétérinaire qui recourt aux principes des contraires, Buffon milite pour l'intégration de la médecine vétérinaire dans la médecine humaine, Lafosse pour une amélioration de la formation des maréchaux ferrants et Claude Bourgelat, un avocat, veut un enseignement distinct qui aboutit à la création de l'Ecole de Lyon et à un corps de vétérinaires en 1761. Après la révolution française, la propriété foncière se modifie et de grands champs de Pomme de terre, de Maïs et de Betterave sucrière apparaissent sous l'effet de la mondialisation des cultures, de la souveraineté nationale et des besoins des populations des villes. Le XIXe siècle est celui de la naissance de l'industrie alimentaire, de la conservation des aliments et de la gastronomie. Les connaissances scientifiques avec la zootechnie, la génétique, la microbiologie permettent un âge d'or de la médecine vétérinaire. Les races bovines prennent une importance considérable et les herd-books font leur apparition. On notera que les premières réflexions sur le droit des bêtes surviennent ainsi qu'un débat sur l'hippophagie. Les chimistes font aussi leur entrée dans l'univers agricole par la fertilisation, les engrais, les besoins de lutte contre le mildiou ou le phylloxéra, le feu de Saint-Antoine ou la carie du blé. L'épouvantable famine en Irlande préside à la naissance des soupes populaires. C'est l'allemand Ernst Haeckel qui invente le mot écologie en 1866 signifiant les sciences de l'habitat, soit la totalité des sciences des relations de l'organisme avec l'environnement. Avec l'écologie les modèles mathématiques sont élaborées, la photosynthèse quantifiée et la sylviculture devient raisonnée. Les géologues sont sollicités au travers de la pédologie, puisqu'il faut mieux comprendre les sols et lutter contre les érosions.
L'apparition du suffrage universel fait des paysans une force politique qui ne se dément pas jusqu'à aujourd'hui. Les écoles agricoles, des journaux spécifiques et des machines font leur apparition, et en Ecole vétérinaire, l'économie rurale est enseignée. Concurrence, protectionnisme, voire patriotisme alimentaire se concrétisent au travers d'un ministère de l'intérieur pour les paysans en 1881. Des caisses rurales d'obédience catholique naissent dans les années suivantes localement, puis au plan national et en 1894, le crédit agricole est fondé. Les premières coopératives sont fondées au Danemark et toute l'Europe en prend l'exemple, notamment pour faire face aux maladies. Nous sommes à l'apogée du cheval de trait. Même si les premiers tracteurs sont mis en marche en 1910-1911, ils ne prendront l'ascendant qu'au début des années 1950. Cette mécanisation s'accompagne de grandes transformations amplifiées par la saignée de main d'oeuvre due à la guerre et à la grippe, et de troubles identitaires majeurs dont la grande littérature se fait parfois l'écho. En 1921, est créée l'Institut de recherche agronomique ancêtre de l'INRA. Dans l'entre-deux-guerres, le syndicalisme se structure sur fond de crise post 1929 et l'office du blé naît en 1936.
Le deuxième tome sera présenté dans la prochaine DT du mois de novembre.