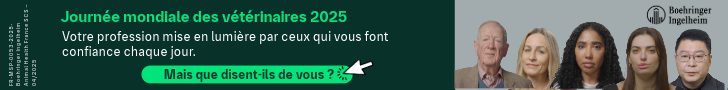Dans quel monde voulons-nous vivre ?
Samedi 22 Octobre 2022 Biodiversité-Faune sauvage 45310© Hélène Soubelet
Hélène SOUBELET
Plus d'une centaine d'États membres de la plate-forme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes), dont la France, se sont réunis à Bonn pour leur neuvième session plénière du 2 au 8 juillet 2022. Après l'adoption du résumé pour décideurs sur l'usage durable des espèces sauvages, qui a fait l'objet d'un article dans la Dépêche technique vétérinaire du mois de septembre 2022 (DT n° 197), intéressons-nous à présent à la seconde évaluation adoptée en 2022, sur les différentes valeurs de la biodiversité dont la typologie est résumée par la figure 1.
LES VALEURS DE LA BIODIVERSITÉ
Quelles sont les différents types de valeurs accordées à la biodiversité dans le monde ?
On appelle valeurs de base (broad values) les principes moraux universels comme la liberté, la justice, la responsabilité, la santé, la prospérité. Ces valeurs sont souvent garanties par les institutions, via des conventions, normes sociales informelles et règles juridiques formelles.
A côté de ces valeurs de base, les sociétés accordent des valeurs spécifiques à la nature (specific values). Elles sont généralement classées en trois catégories : les valeurs instrumentales, les valeurs intrinsèques et les valeurs relationnelles (cf. encadré 1).
Valeurs et visions du monde
L'adhésion aux différentes valeurs sont façonnées par les visions du monde (worldviews) qui sont des prismes au travers desquels les personnes perçoivent, donnent du sens et agissent sur le monde. Les visions du monde ne sont pas mutuellement exclusives. Le contexte, les traditions, les croyances et les institutions peuvent renforcer l'une ou l'autre (cf. encadré 2).
Ces interprétations de la nature et visions du monde aident à expliquer les compromis faits par la société entre protection et exploitation du vivant.
Comment sont liées valeurs et décisions relatives à la biodiversité ?
Le déclin global et sans précédent de la biodiversité (du fait des activités humaines) a largement été documenté par la science. En particulier, les meilleures connaissances disponibles ont été synthétisées dans le gros rapport publié par l'Ipbes en 2019, réunissant 150 scientifiques de 45 pays à partir de plus de 15 000 publications scientifiques.
Les conséquences du déclin de la biodiversité sont massives et impactent déjà la qualité de vie des humains, notamment les plus vulnérables, par la perte de services procurés gratuitement par la biodiversité : les sols sont moins fertiles, les eaux sont moins pures, l'air est plus pollué, la nourriture est moins nutritive, les pathogènes et les espèces exotiques envahissantes prolifèrent.
Si on s'intéresse à présent aux causes de ce déclin, les travaux de l'Ipbes nous rappellent que cinq facteurs directs de pressions expliquent l'érosion du vivant : le changement d'usage des sols, l'exploitation des ressources naturelles, le changement climatique, la pollution et la progression des espèces exotiques envahissantes. Ces facteurs directs de pression sont aggravés par de nombreux facteurs indirects comme la mauvaise gouvernance, la démographie galopante, les modes de consommation (surconsommation), la mondialisation anarchique et les réglementations inéquitables. Ces facteurs indirects aggravent les facteurs directs et sont en liens étroits avec les valeurs accordées à la biodiversité, la nature et le reste du vivant par les décideurs ou les consommateurs (cf. fig. 2).
Comment mesurer les valeurs de la biodiversité et des services écosystémiques ?
Les indicateurs de valeurs sont généralement regroupés en trois groupes : biophysique, monétaire et socioculturel. Si mesurer la valeur de la biodiversité reste un challenge, des avancées importantes ont été faites sur les indicateurs biophysiques et monétaires.
Le nombre d'études d'évaluation de la biodiversité a augmenté en moyenne de plus de 10 % par an au cours des quatre dernières décennies (bien établi ¹).
Plus récemment (2010-2020), les études d'évaluation se sont principalement concentrées sur le statut de la nature (65% des 1163 études d'évaluation examinées) (bien établi), suivi par le rôle de la nature pour la qualité de vie des personnes et la justice sociale (bien établi). Les valeurs instrumentales sont plus souvent évoquées (74 %) que les valeurs relationnelles et intrinsèques (bien établies). La relation homme-nature la plus étudiée dans les études d'évaluation est « vivre de » (41 %), comparé à « vivre avec », « vivre dans » et « vivre en tant que » nature (établi mais incomplet). En ce qui concerne les indicateurs de valeurs, les mesures biophysiques (50 %) prédominent dans les évaluations, suivies des indicateurs monétaires et socioculturels. Mais les méthodes ne sont pas encore consensuelles, pas plus que les indicateurs à comparer. Or, le choix des indicateurs de mesures détermine et guide les actions.
Aujourd'hui, dans le monde, malgré la diversité des valeurs de la nature, les décideurs publics et privés utilisent peu les indicateurs d'une bonne qualité de vie comme la justice, la santé, l'éducation dans leurs décisions.
Cependant, combiner différents indicateurs est un challenge, car les valeurs ne sont directement comparables que lorsqu'elles sont mesurées en utilisant les mêmes métriques. C'est pourquoi pour l'instant, l'essentiels des travaux se concentrent sur l'évaluation monétaire des services écosystémiques (cf. tableau 1).
1 Les principales conclusions de l'Ipbes sont classées en quatre catégories en fonction de la quantité et la qualité des preuves ainsi que sur leur degré de concordance :
Bien établi : méta-analyse complète ou autre synthèse ou études indépendantes multiples qui concordent.
Établi mais incomplet : concordance générale, bien qu'il n'existe qu'un petit nombre d'études ; pas de synthèse complète et/ou les études existantes traitent la question de façon imprécise.
Controversé : il existe de multiples études indépendantes, mais les conclusions ne concordent pas.
Non concluant : preuves insuffisantes, admettant l'existence de lacunes importantes au plan des connaissances.
Les valeurs peuvent-elles changer ?
Les valeurs de base ont tendance à être relativement stables. Cependant, elles peuvent être influencées par exemple, par des programmes d'éducation, des campagnes de sensibilisation, des événements marquants (par exemple, la parentalité) (établi mais incomplet). Ces valeurs ont tendance à évoluer sur des échelles de temps intergénérationnelles, mais peuvent changer plus rapidement en raison de transformations majeures (par exemple, les changements démographiques, les mouvements pro-environnementaux) et de perturbations socio-écologiques (par exemple, les pandémies, les catastrophes naturelles) (établi mais incomplet). En revanche, les valeurs spécifiques sont malléables et peuvent être changées en modifiant les contextes qui déterminent leur priorité. Par exemple, la gestion de l'environnement qui donne la priorité à la biodiversité en tant qu'actif naturel (c'est-à-dire une valeur instrumentale) peut être modifiée par de nouvelles procédures réglementaires qui obligent à la prise en compte des valeurs relationnelles ou intrinsèques (établi mais incomplet).
Les institutions, les conventions et normes sociales informelles, ainsi que les règles juridiques formelles sont sous-tendues par des valeurs sociétales et permettent ou limitent les relations homme-homme et homme-nature. Elles peuvent soit légitimer les valeurs dominantes dans la société et favoriser le statu quo et donc les impacts négatifs sur la nature (cf. par exemple, la faiblesse des réglementations pour contrôler les émissions de carbone), soit privilégier les valeurs comme la responsabilité à l'égard de la nature (par exemple, la loi littorale qui restreint le droit de propriété en faveur de la protection des écosystèmes).
La promotion de changements dans les institutions peut reconfigurer la manière dont les valeurs de la nature sont prises en compte dans différents types de décisions politiques, économiques et socioculturelles {bien établi}. Par exemple, la mise en oeuvre de lois environnementales plus strictes a des effets positifs sur les valeurs qui guident les décisions économiques des entreprises et des consommateurs lorsqu'ils interagissent dans des transactions commerciales.
A côté des institutions, la pression exercée par la société civile peut avoir la capacité de modifier les priorités d'acteurs puissants (par exemple, les engagements contre l'huile de palme et la déforestation ont fait changer les politiques de fonds de pension et de groupes agro-alimentaires) (bien établi). Les changements de valeurs dans la société peuvent également conduire à des changements institutionnels et peut pousser les gouvernements à adopter des lois environnementales plus strictes (établi mais incomplet). Par exemple, la sensibilisation accrue du public à la pollution plastique a activé des valeurs axées sur la durabilité chez les citoyens qui ont fait pression sur les gouvernements pour qu'ils interdisent les produits en plastique à usage unique.
CONCLUSION
À l'échelle mondiale, les décisions économiques donnent généralement la priorité à un petit nombre de valeurs instrumentales, en particulier celles des contributions matérielles de la nature qui sont échangées sur les marchés (par exemple, les aliments, les fibres, l'énergie). Ces décisions ont souvent ignoré les externalités associées aux impacts négatifs sur la biodiversité et les écosystèmes (bien établis). Paradoxalement, ces impacts sont peu ou pas ressentis ou perçus par les populations occidentales, car la technologie, les ressources financières, l'externalisation des impacts sur d'autres territoires permettent pour l'instant de les compenser. Mais il faut avoir conscience que l'érosion massive du vivant a déjà de graves répercussions sur certains groupes humains et en aura de plus graves encore pour les générations futures.
Prendre conscience de l'impact des visions du monde et valeurs accordées au vivant est crucial pour changer de comportement, faire évoluer les institutions et constitue une étape importante de la transition.