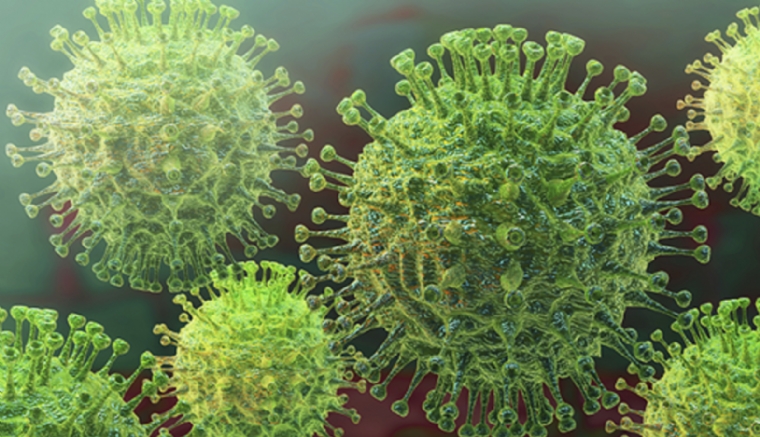Covid-19 : pas de risque particulier venant des animaux et de l'alimentation, selon l'Anses
Mercredi 18 Mars 2020 Sciences 35763L'Anses a été saisie en urgence, le 2 mars, par la Direction générale de l'alimentation qui s'inquiétait notamment des risques dans le secteur agro-alimentaire.
© Anses
Michel JEANNEY
Santé publique
Interrogée sur la transmission potentielle de la maladie Covid-19 par l'intermédiaire d'animaux domestiques ou d'aliments contaminés, l'Anses* a réuni en urgence un groupe d'experts spécialisés pour répondre à cette question. Sur la base de leur rapport, elle conclut qu'à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, il n'existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d'élevage jouent un rôle dans la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'origine du Covid-19.
Depuis son émergence, en décembre 2019, en Chine, les connaissances acquises sur le coronavirus SARS CoV-2, responsable de la maladie Covid-19, montrent que la voie principale de transmission de l'agent infectieux est interhumaine. La contamination s'effectue par contact entre les personnes ou à travers l'inhalation de gouttelettes infectieuses émises par les patients lors d'éternuements ou de toux.
Néanmoins, comme la structure génétique du virus indique une source originelle animale probable, l'Anses* a été saisie en urgence, le 2 mars, par la Direction générale de l'alimentation qui s'inquiétait notamment des risques dans le secteur agro-alimentaire.
Elle a donc mobilisé un groupe d'expertise collective d'urgence sur le rôle potentiel des animaux domestiques et des aliments dans la transmission du virus. Les experts ont rendu un avis plutôt rassurant - de ce point de vue -, le 9 mars, qui a été publié le 11 mars.
Passage du virus de l'Homme vers l'animal peu probable
Concernant une éventuelle transmission du virus par des animaux d'élevage et des animaux domestiques, le groupe d'experts formule trois conclusions principales.
Tout d'abord, dans le contexte actuel et au vu des informations disponibles publiées, le passage du SARS-CoV-2 de l'être humain vers une autre espèce animale semble actuellement peu probable.
Les experts rappellent toutefois que, par sa structure génétique, le virus SARS-CoV-2 semble effectivement avoir pour source initiale un animal. Il provient probablement d'une espèce de chauve-souris avec ou sans intervention d'un hôte intermédiaire.
Deuxième conclusion, même si le récepteur cellulaire par lequel le virus SARS-CoV-2 se lie pour entrer dans les cellules est identifié chez des espèces animales domestiques et semble capable d'interagir avec le virus humain, les experts rappellent que la présence du récepteur n'est pas une condition suffisante pour permettre l'infection de ces animaux.
En effet, le virus n'utilise pas seulement le récepteur mais aussi d'autres éléments de la cellule qui lui permettent de se répliquer. Le groupe souligne cependant que les études à ce sujet doivent être approfondies.
Enfin, troisième conclusion, si le génome du virus a été détecté dans les cavités nasales et orales d'un chien au contact d'un patient infecté à Hong Kong, la détection du génome n'est pas une preuve suffisante pour conclure à une infection de l'animal.
Une contamination passive n'est pas, en effet, à exclure, indiquent les experts, notamment du fait de la survie possible du virus sur une muqueuse humide sans nécessairement s'y répliquer.
Au vu de ces éléments, ils soulignent « la nécessité d'investiguer de façon plus approfondie ce cas en réalisant des analyses supplémentaires et de poursuivre la communication des résultats au fur et à mesure de leur réalisation ».
Pas de transmission par voie digestive directe
Concernant la transmission potentielle du virus via les aliments, les experts, considérant que la contamination d'un animal est peu probable, estiment que la possibilité de transmission directe du virus par un aliment issu d'un animal contaminé est exclue.
Seule donc l'hypothèse de la contamination de l'aliment, par un humain malade ou porteur asymptomatique du virus SARS-CoV-2, a été investiguée. La contamination pourrait avoir lieu par le bais de gouttelettes respiratoires issues d'un patient contaminé. Toutefois, la question de la voie féco-orale se pose, des particules virales ayant été détectées dans les selles de certains patients.
A ce sujet, les experts tirent également trois conclusions.
En premier lieu, dans l'état des connaissances à ce jour, la transmission du virus SARS-CoV-2 par voie digestive directe est écartée.
En effet, si l'on observe la présence du virus dans les selles de patients, il est vraisemblable qu'elle s'explique par la circulation du virus dans le sang suite à l'infection respiratoire plutôt que par voie d'entrée digestive.
Toutefois, la possibilité d'infection des voies respiratoires lors de la mastication ne peut pas être totalement exclue, préviennent-ils.
Deuxième conclusion, comme, par analogie avec d'autres coronavirus connus, ce virus est sensible aux températures de cuisson, un traitement thermique à 63 °C pendant 4 minutes (température utilisée en liaison chaude en restauration collective) permet de diviser par 10 000 la contamination d'un produit alimentaire.
Enfin, troisième conclusion, même si une personne infectée peut contaminer les aliments en les préparant ou en les manipulant avec des mains souillées ou en les exposant à des gouttelettes infectieuses lors de toux et d'éternuements, appliquées correctement, les bonnes pratiques d'hygiène sont une manière efficace de prévenir la contamination des denrées alimentaires par le virus SARS-CoV-2.
Pas d'inactivation par le froid
Le groupe d'expertise souligne également que « toute personne malade doit connaître l'importance de ne pas manipuler des aliments si elle présente des symptômes de gastro-entérite (diarrhée, fièvre, vomissements, maux de tête) mais aussi, dans le contexte actuel, d'un syndrome grippal ».
Il relève par ailleurs que « les données actuelles montrent que les coronavirus semblent stables à des températures basses et négatives ». En d'autres termes, la réfrigération et la congélation ne constituent pas un traitement d'inactivation pour ce virus.
D'une manière générale, les experts soulignent « l'incertitude « moyenne » attachée à ces conclusions, compte tenu du nombre limité d'études scientifiques sur ce nouveau virus ».
« De nouveaux faits scientifiques, qui viendront compléter les connaissances sur ce virus, pourront modifier cette incertitude », concluent-ils. ■
Encore plus d'infos !
L'avis est en ligne à l'adresse https://bit.ly/33eDOZ3.
* Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.