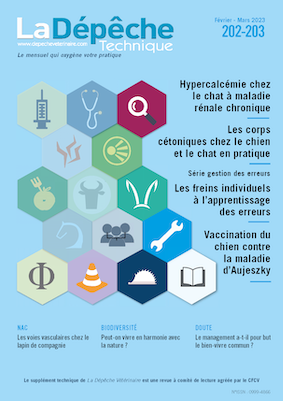COP15 : Peut-on vivre en harmonie avec la nature ?
Samedi 18 Mars 2023 Biodiversité-Faune sauvage 46959Hélène SOUBELET
La quinzième réunion des Etats parties (Conférence des parties ou Cop) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a eu lieu en décembre 2022 après deux ans de reports dus à la pandémie Covid19.
Face à l'érosion de la biodiversité, réaffirmée en 2019 par la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, l'ambition de cette Cop était importante, car il s'agissait d'adopter un nouveau cadre mondial pour les dix prochaines années afin d'atteindre en 2050 l'objectif de « vivre en harmonie avec la Nature ».
Un mois après la fin des négociations, quelles ont été les avancées et quelles en sont les implications pour les Etats, les entreprises, les citoyens ?
UN NOUVEAU CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ
En 2010, les Etats parties à la convention sur la diversité biologique avaient adopté un premier cadre constitué de vingt objectifs (nommés les objectifs d'Aïchi) qui avait pour ambition de réduire, d'ici 2020, les pressions sur la biodiversité, améliorer son état en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique, et accroître, pour tous, les avantages issus de la biodiversité et des écosystèmes.
Bien avant 2020, il a été assez clair qu'aucun de ces objectifs n'allait être atteint et que l'érosion de la biodiversité, loin d'avoir été stoppée, avait en réalité été accélérée.
Le nouveau cadre discuté dès 2019 a donc été orienté vers l'identification des points de blocage, des points de leviers et la mise en oeuvre du changement transformateur préconisé par les scientifiques. Ce cadre reconnaît donc que seule une transformation en profondeur de notre économie, nos modes de vie, nos habitudes de production et de consommation, coordonnée aux échelles locales, nationales et globale, peut enrayer le déclin du vivant et sortir l'humanité de l'impasse mortifère dans laquelle elle s'est engagée.
La grande avancée est que ce cadre préconise une approche systémique de la biodiversité dans tous les territoires et pour toutes les activités humaines. Il rappelle que nos styles de vie et nos modes de consommation déterminent, de la manière la plus fondamentale, nos impacts sur la biodiversité et son devenir.
Ce nouveau cadre reprend largement les objectifs d'Aichi et ceux de la convention. Les Etats, les entreprises, les citoyens sont donc encouragés à protéger et restaurer la biodiversité, en faire un usage durable, partager équitablement ses avantages, mettre en oeuvre les leviers et actions transformatrices nécessaires.
OBJECTIF 1 : protéger et restaurer la biodiversité
Restaurer les écosystèmes dégradés ou des populations en danger d'extinction et protéger de la dégradation des espaces suffisants, des espèces rares, emblématiques ou ordinaires sont des actions qui ont fait leurs preuves.
Ainsi, plusieurs cibles adoptées à la Cop 15 y sont consacrées. La cible 2 prévoit la restauration de 30% au moins des écosystèmes dégradés, la cible 3 prévoit la protection de 30% au moins de tous les écosystèmes terrestres et marins, la cible 4 prévoit que les extinctions d'origine humaine d'espèces connues soient stoppées et que la diversité génétique des populations soit restaurée. La restauration des écosystèmes dégradés peut être du ressort de tout un chacun dès lors qu'il détient un pouvoir de décision sur un espace ou sur des actions détruisant des écosystèmes. La création d'espaces protégés en revanche, est principalement du ressort des Etats, mais de plus en plus d'actions de mise en protection sont entreprises par les entreprises ou organisations privées, voire même les citoyens sur tout ou partie des espaces dont ils ont la gestion (emprises des activités, jardins privés etc.). Rappelons que les objectifs d'Aichi avaient fixé cette ambition à 17% et n'avaient pas pu être atteints. L'arrêt des extinctions d'origine humaine peut également concerner toute activité qui impacte les espèces protégées, par exemple, en France, la chasse des 20 espèces en mauvais état de conservation selon la classification de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la Nature) pourrait être stoppée.
OBJECTIF 2 : utiliser la biodiversité de manière durable et réduire les pressions sur le vivant
Le cadre mondial entérine un élément important qui est de maintenir et restaurer l'intégrité de tous les écosystèmes, qu'ils soient naturels, anthropisés ou gérés (cible 1). L'intégrité biologique peut être approximée par trois dimensions que sont la diversité de la composition, de la structure et des fonctions écologiques des écosystèmes. Les écosystèmes agricoles et urbains sont notamment concernés, avec des possibilités de synergies avec la FAO et l'Unesco qui ont déjà adopté cet objectif.
Au-delà de maintenir des espaces intègres, il est également important de baisser le niveau global de nos pressions sur tous les écosystèmes naturels et anthropisés. Le cadre enjoint à prévenir la surexploitation des écosystèmes (cible 5), prévenir l'introduction et l'établissement des espèces exotiques envahissantes (cible 6), à diminuer la pollution (cible 7) et notamment la pollution par les pesticides, les produits chimiques hautement dangereux et les nutriments, et enfin, à s'assurer que les actions de réduction du changement climatique ne soient pas néfastes à la biodiversité (cible 8).
La réduction des pressions est un élément clé pour parvenir à une meilleure coexistence, à une cohabitation harmonieuse avec la nature, d'autant que cet objectif peut être mis en oeuvre à toutes les échelles : celle de l'Etat, celle des entreprises et celle des citoyens. Cinq cibles du cadre mondial permettent de mieux cerner les actions possibles, en particulier pour l'aménagement des territoires, par la diminution des impacts de l'agriculture, la gestion durable des espèces sauvages et de l'atténuation du changement climatique.
OBJECTIF 3 : partager les avantages issus de la biodiversité pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population
Des trois objectifs de la CDB, le dernier, relatif au partage des avantages issus de la biodiversité, est de loin le moins connu. C'est pourtant un objectif essentiel pour atteindre l'ambition de " vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050 ". Longtemps cantonné aux ressources génétiques, le nouveau cadre lui donne une ampleur inattendue en reconnaissant à travers cinq cibles que des avantages sociaux, économiques et environnementaux découlent de l'usage durable du vivant et du partage des bénéfices.
En premier lieu, il s'agit de reconnaître que toute action sur la biodiversité peut avoir des conséquences en termes de perte de fonctions et de services écosystémiques et que ceci peut porter préjudice à des populations vulnérables qui ne bénéficient pas économiquement de l'activité impactante.
Toute activité doit donc restaurer, maintenir et améliorer les services écosystémiques pour le plus grand nombre. Ainsi, les décideurs publiques et privés sont encouragés à évaluer l'impact de leurs décisions sur les services écosystémiques et ainsi, les rendre plus justes en s'assurant qu'elles ne sont pas à l'origine d'un accaparement au détriment des populations locales (cible 13), des femmes et des filles (cible 23) ou d'une perte disproportionnée des avantages issus de la biodiversité pour les personnes ou les écosystèmes (cible 11). Ceci est particulièrement vrai pour l'usage des espèces sauvages (cible 9), les pratiques agricoles qui ne doivent pas priver la société des services écosystémiques de régulation notamment (cibles 10), de l'aménagement urbain qui doit permettre la santé et le bien-être des habitants (cible 12).
OBJECTIF 4 : outils et solutions pour la mise en oeuvre et l'intégration
Ce qui manquait le plus aux objectifs d'Aichi, c'étaient des moyens et des leviers pour la mise en oeuvre. En 2019, l'Ipbes a proposé un cadre méthodologique pour mettre en relation les activités humaines, les pressions directes sur la biodiversité et les facteurs indirects aggravant les pressions. Ce nouveau cadre propose 10 cibles pour garantir la levée des freins à la prise en compte de la biodiversité et à la restauration de l'intégrité écologique des écosystèmes. En particulier, il préconise d'aligner toutes les activités, publiques et privées sur les objectifs du cadre mondial (cible 14), il encourage les entreprises et institutions financières à réduire leur impact négatif en le contrôlant et en fournissant assez d'informations au consommateur pour lui permettre de faire des choix éclairés (cible 15). Il recommande la réduction de l'empreinte mondiale de la consommation, reconnue pour être le principal facteur explicatif de la perte de biodiversité, la réduction du gaspillage, de la surconsommation et de la production de déchets (cible 16), le renforcement des mesures de biosécurité et celles relatives aux biotechnologies (cible 17), l'élimination progressive des subventions néfastes à la biodiversité (cible 18).
Les cibles 19 à 22 (voir page suivante), quant à elles, appellent à dédier des ressources financières suffisantes pour les stratégies nationales destinées à mettre en oeuvre le cadre, à renforcer les capacités de toutes les parties en matière d'accès aux technologies, innovations et coopération scientifique et technique, à garantir un accès aux données, informations et connaissances pour éclairer la décision à tous les niveaux et à assurer une participation juste et inclusive et un accès à la justice pour les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les peuples autochtones et communautés locales.
CONCLUSION
L'adoption de trois conventions au sommet de la terre de 1992 des Nations unies avait suscité beaucoup d'espoirs, avec des objectifs ambitieux pour le climat, la biodiversité, la désertification. Malheureusement, 30 ans après, le constat était celui d'un échec et les efforts à faire pour enrayer le déclin du vivant, éviter les effets délétères de la désertification et du bouleversement du climat sont de plus en plus importants et coûteux. Il n'est plus aujourd'hui possible d'avancer par petits pas, comme ont alerté l'Ipbes et le Giec.
L'humanité a besoin d'un changement transformateur de son économie, de ses habitudes, de ses modes de consommation et de production pour atteindre et conserver un niveau de vie et un bien-être acceptables et partagés.
Malgré quelques reculs d'ambition sur la suppression des subventions néfastes ou la réduction des impacts du secteur privé, le nouveau cadre est plus ambitieux sur un certain nombre de visions écologiques et sociales et il présente une vision systémique en reconnaissant le rôle et la responsabilité des valeurs sociales, des comportements individuels ou des styles de vie dans l'érosion du vivant et comme moteurs du changement.
Ce cadre ne se substitue pas aux devoirs et obligations des Etats, des parties prenantes et des citoyens, il pose les ambitions, décrit la responsabilité des secteurs ayant le plus d'impact, agricole, industriel, financier, et propose des outils pour rendre les trajectoires sociales, économiques, écologiques soutenables et en rendre compte.
La transformation vers la soutenabilité exige à présent que les pays, les entreprises, les citoyens se saisissent du cadre pour définir eux-mêmes des actions de mise en oeuvre compatibles avec leurs contextes démographique (densité humaine), économique (niveau de vie et de développement), politique, social (habitudes de consommation) et écologique (état de dégradation des écosystèmes, état d'intensification de l'agriculture).
En particulier, au niveau national, l'intervention publique est indispensable pour transformer les modèles économiques et garantir la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques au bénéfice du plus grand nombre.
Les structures privées sont appelées, quant à elles, à se montrer responsables, transparentes et engager une trajectoire de diminution de leurs pressions sur le vivant.
Les citoyens, les consommateurs doivent rendre soutenable leur consommation, s'extirper du modèle de surconsommation produisant des déchets et du gaspillage.