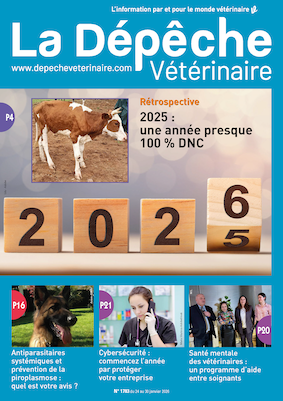Conclusion : One Health One Pain
Des constats similaires
- En médecine humaine, les chiffres sont alarmants : plus de 20 % de la population française est affectée par des DCs d'intensité modérée à sévère 125.
Deux patients sur trois ne sont pas soulagés par leur traitement et 1 sur 2 a une qualité de vie très altérée. 43 % des consultations chez un médecin généraliste ont un motif de douleur dont 24 % en chronicisation. Enfin, l'enquête «PainSTORY» 5, réalisée en 2009, démontre que 44 % des patients déclarent se sentir seuls dans leur combat contre la douleur et deux patients sur trois se sentent anxieux ou déprimés en raison d'une douleur chronique [enquête «Pain STORY» : Pain tracking on going responses for a year - sept 2009 (https://painstory.org.fr)].
Malgré l'excellence française des structures dédiées à la prise en charge des DCs, moins de 3 % des douloureux chroniques bénéficient d'un accès à ces centres spécialisés.
- En médecine vétérinaire, la douleur est le premier motif de consultation médicale. La grande majorité des douleurs inflammatoires est associée à l'arthrose dont la prévalence est de 20 % de la population canine adulte et de 70 % des chiens de plus de 8 ans 3.
Chez le chat, la prévalence de l'arthrose est de 61 % chez les chats âgés de plus de six ans, de 70 % chez les chats âgés de plus de 11 ans pour atteindre 90 % des chats âgés de plus de 12 ans.
- 10 % de la population humaine adulte en France est atteinte d'arthrose : cette prévalence de 70 % est retrouvée chez les hommes et les femmes de plus de 75 ans.
La concordance des arthroses humaine et canine ne se limite pas à ces chiffres : la physiopathologie complexe de l'arthrose oblige à la même vision pluritissulaire dans laquelle le cartilage, l'os sous-chondral et la membrane synoviale subissent des stress mécaniques et biologiques inflammatoires. Les facteurs de risque (âge, obésité) et les localisations mono ou polyarticulaires sont semblables. Les cliniciens médecins et vétérinaires constatent la même dissociation radio-clinique entre les changements structuraux et le niveau de douleur. Les chercheurs ont montré par des études d'IRM fonctionnelle la même activation des zones cérébrales impliquées dans les DCs chez l'homme et le chat 126.
L'arthrose, à bien des égards, est une épidémie silencieuse, car elle est souvent sous-diagnostiquée.
Des causes partagées
Au-delà de l'arthrose, c'est l'ensemble des DCs qui pâtit dans les deux médecines d'une situation d'échecs de prise en charge à l'origine de nomadisme médical et d'errance thérapeutique.
Les causes sont multifactorielles :
1°/ la résignation et le fatalisme amènent souvent à l'équation « âge = douleurs », d'autant plus que ces constats sont parfois partagés par les soignants eux-mêmes ;
2°/ une approche mécanistique de la douleur trop cloisonnée à l'origine d'orientations thérapeutiques formatées alors que la douleur doit plutôt s'envisager comme un continuum mouvant entre les formes inflammatoires, neuropathiques et nociplastiques ;
3°/ l'objectif irréaliste du zéro douleur, de la disparition totale du handicap fonctionnel et d'un retour d'équilibre (homéostasie) à un état initial vierge de souffrances ;
4°/ la sous-estimation du ressenti émotionnel, indispensable indicateur de la qualité de vie, et le défaut de stratégies de coping (stratégies d'adaptation consistant à vivre ou à faire face à un handicap), dont l'ergothérapie et les modifications de l'environnement ;
5°/ l'approche médicamenteuse exclusive alors que, selon les mots du Pr Alain Eschalier, notre pharmacopée est ancienne, stéréotypée, peu innovante et montrant des ratios bénéfices / risques insuffisants ;
6°/ par conséquent, un défaut d'approche pluridisciplinaire privilégiant les solutions pharmacologiques, les biothérapies et les méthodes complémentaires.
7°/ un temps de consultation dédié aux DCs insuffisant parce que non valorisé alors que les demandes des patients ou des propriétaires d'animaux sont claires : écoute, empathie, suivi, etc. ;
8°/ une approche protocolisée uniforme au détriment d'un projet thérapeutique individualisé.
Des réponses communes : la révolution one health one pain
La crise sanitaire actuelle a montré, si besoin était, le lien entre le monde humain et le monde animal non humain, validant la réalité du concept One Health. Ce concept peut également s'appliquer à la douleur. L'évolution de la nouvelle définition de la douleur par l'IASP, rappelée plus haut, en est la parfaite illustration. Cette transversalité homme-animal de la douleur concerne d'ailleurs, à la fois, les dimensions physiologique, physiopathologique, diagnostique, socio-comportementale, thérapeutique et éthique, même s'il convient d'admettre les spécificités du monde humain et du monde animal et en leur sein celle des individus.
En termes physiologiques, les mécanismes de la nociception sont proches, de la transduction du signal nociceptif à sa conduction, transmission, intégration et modulation. Ainsi homme et animaux disposent-ils tous de ce mécanisme de signal/défense face à une agression susceptible de porter
atteinte à l'intégrité de leur organisme.
Dans les deux contextes, l'intensité et/ou la persistance des facteurs inducteurs, souvent secondaires à des lésions tissulaires, peuvent être à l'origine d'une douleur justifiant un recours thérapeutique. Passant de la physiologie à la physiopathologie, des mécanismes variés viennent, via la neuroplasticité, modifier le fonctionnement des cellules (neurones et cellules gliales) du système nerveux et engendrer des réponses et une mobilisation accrue des systèmes pronociceptifs ou une réduction de l'activité des systèmes inhibiteurs. Ces changements sont à l'origine de douleurs soit aiguës soit chroniques si des modifications spécifiques et pérennes se produisent.
Le contexte One Health One Pain peut également se décliner au stade diagnostique, spécifiquement pour la douleur chronique, où non seulement l'identification de la nature du trouble est nécessaire (douleur nociceptive, neuropathique ou nociplastique) mais également sa fine caractérisation sémiologique. En effet, la triade diagnostique classique apparaît insuffisante dans les deux contextes homme/animal. Des mécanismes différents peuvent être impliqués dans un cadre diagnostique identique. Il est donc essentiel de finement caractériser les patients douloureux chroniques, intégrant le caractère pluridimensionnel et individuel des douleurs. Cette démarche qui peut aujourd'hui bénéficier d'outils numériques et d'un suivi en vie réelle, est de nature à permettre à terme une meilleure personnalisation des traitements assurant une meilleure efficacité. Elle doit, au-delà de la seule évaluation de la douleur stricto sensu, intégrer l'évaluation de ses composantes comportementales (patient et son entourage), cognitives ou sociales et de ses co morbidités.
Ainsi, que ce soit chez l'homme ou l'animal, l'état global du patient sera appréhendé (PRO : patient report outcomes pour l'homme, CSOM : Client Specific Outcome Measures pour l'animal) et constituera, avec l'impact sur son environnement, un élément clé dans l'évaluation du trouble douloureux et de ses conséquences. Cette nécessaire évaluation sous-entend une individualisation de l'approche d'autant plus vraie, sans doute en médecine vétérinaire, que la variété des espèces à traiter est particulièrement large et source de spécificités. Une telle démarche aura un impact très positif sur la prise en charge des patients. En médecine humaine, la thérapeutique n'en est, hélas, pas là aujourd'hui. La prise en charge pharmacologique n'est pas optimale à la fois du fait d'une balance bénéfice/risque insatisfaisante et d'une innovation trop limitée.
Ainsi, les thérapeutiques médicamenteuses actuelles sont, en particulier pour les douleurs chroniques, soit d'efficacité limitée, soit mal tolérées, soit inefficaces. Même si des innovations apparaissent, par exemple pour les douleurs de l'arthrose, des progrès sont nécessaires et attendus. En médecine vétérinaire, les prometteuses biothérapies dont les anticorps monoclonaux sont susceptibles d'améliorer cette balance bénéfice/risque et donc d'apporter des réponses au défi de la prise en charge des douleurs arthrosiques chroniques.
Ces progrès pourraient également s'inscrire dans le concept One Health One Pain. En effet, face au peu d'innovation en appliquant les stratégies classiques de conception de nouveaux médicaments, il apparaît nécessaire de définir une autre stratégie basée sur les patients, inspirateurs des recherches. Une telle stratégie s'applique très directement en clinique avec l'objectif de travailler sur une meilleure caractérisation et une stratification pour aboutir à une personnalisation thérapeutique. Mais elle doit s'appliquer aussi à la recherche fondamentale via une recherche translationnelle inverse, du patient au laboratoire et retour. Dans ce contexte, il est évident qu'une collaboration accrue entre vétérinaires, médecins et chercheurs permettrait de renforcer les capacités d'innovation grâce à des travaux chez des patients animaux, plus pertinents que les modèles de laboratoire pour aboutir à de réels progrès.
Des réponses communes : de l'homme douloureux à l'animal douloureux
Une des réponses à ce défi partagé consiste donc à changer nos regards sur la compréhension des mécanismes intimes des DCs sur nos pratiques évaluatives, sur notre approche pluridisciplinaire et sur la co-décision d'un projet thérapeutique individualisé : soigner l'animal douloureux et l'inscrire dans un parcours de suivi, clé d'une observance réussie.