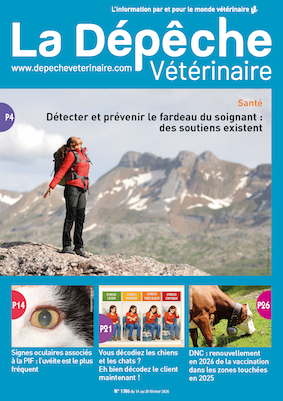Au-delà de la prédation, l'effet des carnivores sur les paysages
© Pascale Bradier-Girardeau
Hélène SOUBELET
Le rôle des grands prédateurs dans la structure et les fonctions des écosystèmes, est bien documenté scientifiquement. Ils régulent l'abondance de leurs proies, ce qui a des effets en cascades sur les niveaux trophiques inférieurs. Ils peuvent, par exemple, favoriser certaines plantes en diminuant le taux d'herbivorie. Ils induisent également des changements de comportements chez leurs proies qui peuvent limiter leur déplacement, éviter les zones dégagées, réduire leurs interactions sociales, ce qui, par rebond, peut procurer des services écosystémiques comme la diminution des accidents de la route (Navarro et Plancke, 2024) ou la régulation de maladies, par exemple la maladie de Lyme (Soubelet, 2017). Le cas très documenté de la réintroduction des loups (Canis lupus) dans le parc du Yellowstone montre qu'ils ont affecté à la fois la densité de population et, dans une moindre mesure, l'utilisation de l'espace par les wapitis (Cervus canadensis), ce qui a eu un effet en cascade faible, mais mesurable sur le recrutement des arbres (Brice et al. 2022).
De plus en plus d'études montrent des mécanismes additionnels intéressants, comme leur impact sur le paysage et leur effet sur le cycle des nutriments. Néanmoins, les études antérieures n'ont pas souvent pris en compte la multitude des interactions interspécifiques et les effets indirects (par exemple, interactions avec des charognards, prédation opportuniste, risque/transmission des agents pathogènes).
Une publication récente de chercheurs Etats-Uniens et canadiens, publiée en 2023 (Johnson-Bice et al. 2023), analyse ces mécanismes qui créent de l'hétérogénéité dans les écosystèmes, et donc, favorisent la biodiversité. A travers des études de cas, les auteurs se sont appuyés sur une grande diversité de taxons et de disciplines écologiques - écologie des plantes et des sols, écologie comportementale, écologie spatiale et dynamique des réseaux trophiques. Prendre en compte ces autres processus est indispensable pour mieux comprendre l'intégralité des effets de la de la présence des carnivores.
Rôle de la régulation des ingénieurs des écosystèmes 1
1 Qualificatif attribué aux espèces qui créent et entretiennent des biotopes particuliers et influencent la disponibilité des ressources pour d'autres espèces en modifiant physiquement leur environnement (Jones et al. 1994)
Une majorité des espèces ingénieures des écosystèmes occupent des niveaux trophiques moyens. Elles sont donc soumises à la prédation, mais les parcelles qu'elles ont créées persistent souvent au-delà de la mort des individus. Un cycle se met en place avec des périodes d'occupation, d'abandon et de recolonisation qui sont influencées par la dynamique de la population des ingénieurs et le taux d'occupation des parcelles. Dans ces scénarios, les prédateurs ont des impacts locaux inféodés à la structure de la parcelle artificielle concernée et au temps nécessaire à l'écosystème pour se rétablir. D'un point de vue paysager, ces processus démographiques et écologiques conduisent à une mosaïque de parcelles à différents stades d'occupation/abandon augmentant l'hétérogénéité, ce qui est toujours favorable au plus grand nombre d'espèces.
Peu d'études ont évalué les effets indirects des interactions prédateurs-ingénieurs des écosystèmes ce qui rend difficile l'estimation de la fréquence à laquelle les prédateurs modifient les écosystèmes en tuant des ingénieurs. En détruisant les colonies de fourmis coupeuses de feuilles (Atta sp.), les prédateurs comme les tatous et les fourmis légionnaires réduisent l'abondance des colonies d'Atta, empêchant ainsi la transformation des communautés forestières tropicales par leur herbivorie (Terborgh et al. 2001).
Le cas d'école de cette dynamique, ce sont les interactions entre les loups et les castors canadiens (Castor canadensis) étudiées par Gable et collaborateurs (2020) (cf. encadré 1).
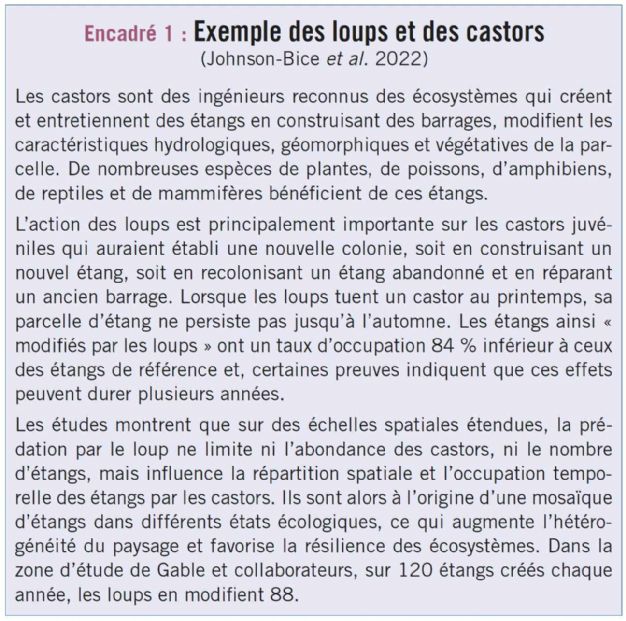
Rôle dans le cycle des nutriments
Les animaux sont mobiles et de ce fait, ils créent des liens entre les écosystèmes qu'ils traversent et sont indispensables pour les dynamiques des méta-écosystèmes en permettant des fonctions comme la dispersion des graines et le transport de nutriments, de biomasse et d'énergie. Les carnivores sont importants dans ces processus, en particulier pour le transport et la concentration du calcium, de l'azote et du phosphore qui souvent sont des facteurs limitants en raison de leur rareté (Monk et Schmitz, 2022). Lorsque l'action des prédateurs concentre leurs proies dans des lieux précis, cela crée des zones nutritives contrastées dans les écosystèmes. On parle d'effet « patch nutritif ».
Les écosystèmes avec des taux de récupération et de renouvellement plus lents bénéficient plus des concentrations de nutriments qui auront une plus grande importance écologique relative par rapport aux écosystèmes avec des taux de récupération et de renouvellement plus rapides.
Rôle des charognes
(cf. encadrés 2, 3, 4 et 5)

Contrairement aux autres types de mortalités, qui sont plus aléatoires, les prédateurs déposent régulièrement des carcasses dans leurs zones de chasse et permettent une meilleure répartition de la ressource pour de nombreux êtres vivants. Les repaires des carnivores sont souvent des lieux d'accumulations de nutriments, car les adultes y amènent leurs proies pour nourrir leurs petits et leurs environs immédiats accumulent également des excréments.
Les communautés d'invertébrés sont plus abondantes dans les zones de charognes et les individus sont plus grands. Cette abondance d'arthropodes attire à son tour d'autres espèces vers les carcasses qui constituent ainsi des sites d'attractions pour d'autres prédateurs qui y trouvent leurs proies. A contrario, certains petits animaux évitent volontairement les carcasses pour éviter la prédation, le parasitisme ou le risque d'infection. Certains chercheurs ont nommé cette répulsion « paysage de dégoût » (Buck, 2018). De même, les espèces vulnérables aux parasites évitent les latrines du raton laveur (Procyon lotor), mais les espèces tolérantes aux maladies y sont attirées (Weinstein et al. 2018).
Au fur et à mesure que les carcasses se décomposent, des éléments nutritifs limitants comme le carbone, l'azote et le phosphore s'infiltrent dans le sol, ce qui augmente sa teneur en éléments nutritifs par rapport aux sites témoins, nourrit les champignons et les organismes du sol et améliore la croissance des plantes à proximité immédiate.
La reproduction des mouches et des coléoptères participe à la conversion de la chaire en nutriments (azote, phosphore). Les communautés végétales spécifiques des zones de charognes peuvent persister pendant plusieurs années après la décomposition complètes de la carcasse et forment des patches de couleur différentes dans les paysages : ainsi, les carcasses de la toundra arctique modifient la composition floristique pendant des décennies ou plus (Danell et al. 2002).
Plus la carcasse est de grande taille, plus son effet patch sera significatif dans la dynamique de l'écosystème : il a ainsi été démontré qu'une carcasse de chevreuil (Capreolus caprelous) d'une vingtaine de kilos n'avait aucun effet détectable sur le sol ou les plantes (Teurlings et al. 2020), contrairement aux grands ongulés tués par des prédateurs (Peziol et al. 2023). Plus le nombre de carcasses est important, plus la probabilité qu'elles influencent la dynamique des écosystèmes sera grande : malgré la petite taille des carcasses de saumon, elles peuvent avoir des effets importants sur les écosystèmes en raison de leur présence en grand nombre (Voir DT n°193-194, de mars-avril 2022). De même, il existe une rétroaction entre la répartition des proies et des carcasses prédatées dont l'emplacement est influencé par des mécanismes de « paysage de la peur » qui ont modifié en premier lieu la répartition des proies.
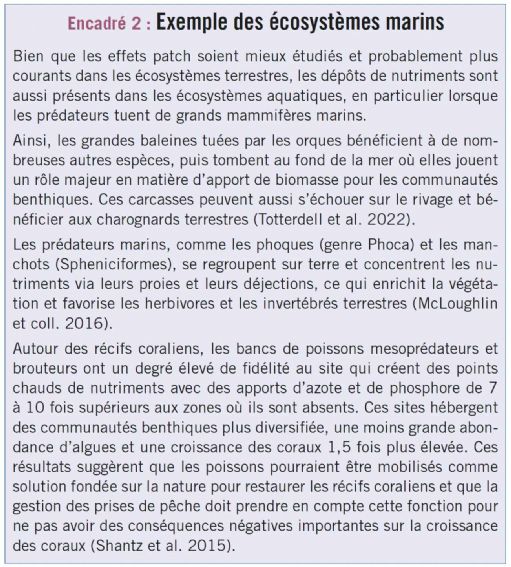
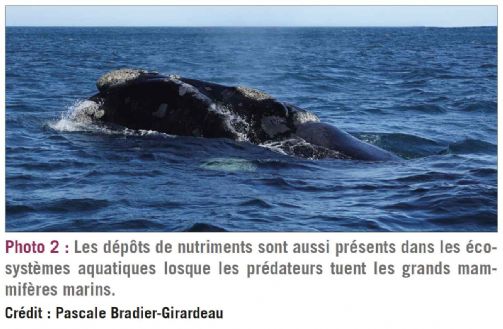
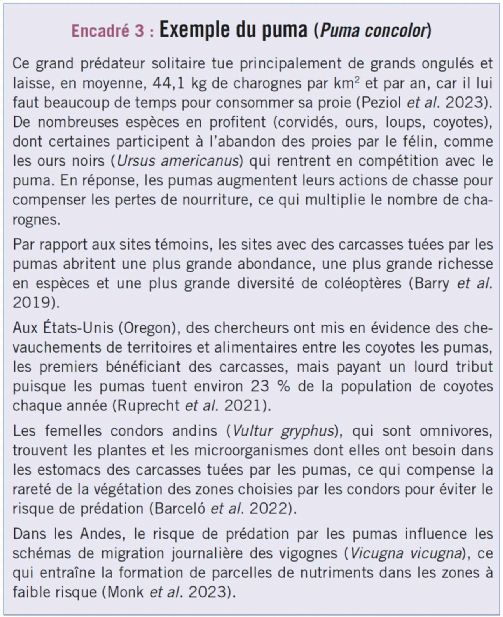
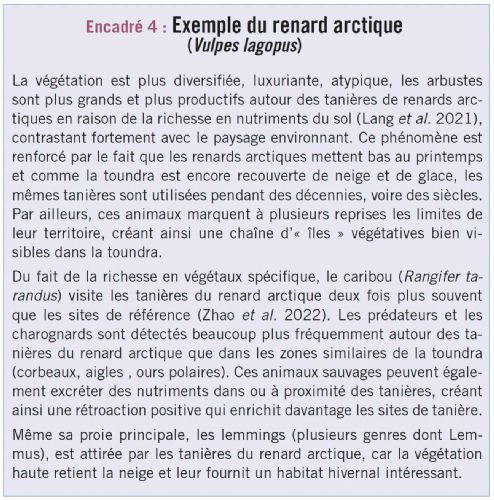
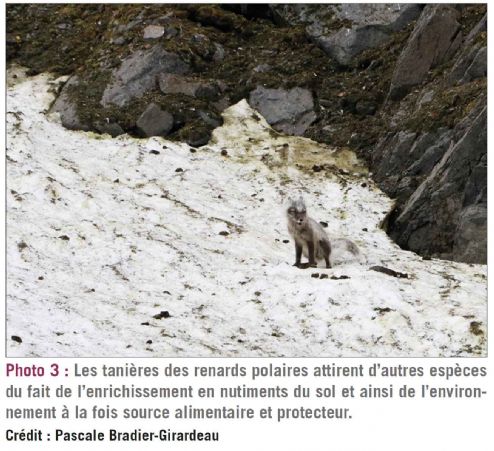
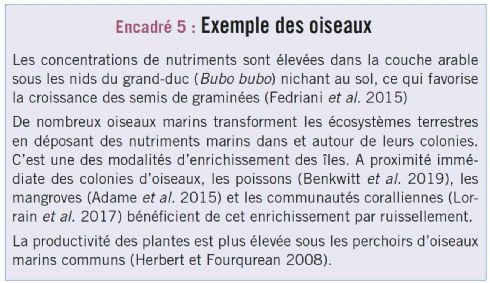

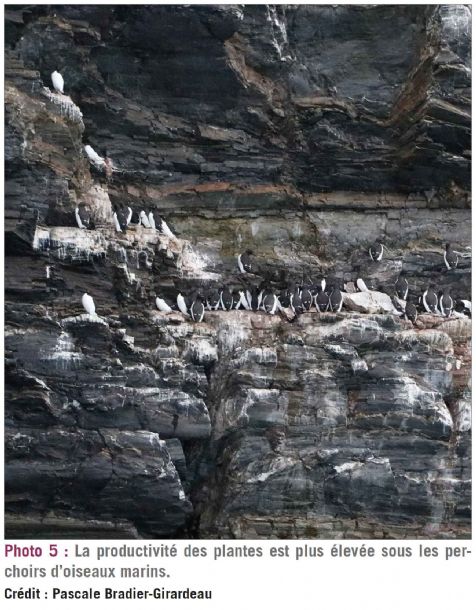
Conclusion
La majorité des recherches sur ces sujets (et donc les exemples fournis) sont orientées vers les grands mammifères terrestres de l'hémisphère nord.
Néanmoins, cette étude permet de mieux comprendre pourquoi plus les écosystèmes sont en bonne santé écologique, plus ils abritent une grande diversité de prédateurs et plus ils bénéficieront de tous leurs services écosystémiques dans un cercle vertueux qu'il faut préserver et contribuer à renforcer.
À ce jour, la justification de la conservation, de la gestion et de la réintroduction des prédateurs est souvent basée sur leur capacité à influencer les écosystèmes par le biais de changements dans l'abondance et les caractéristiques des niveaux trophiques inférieurs. Cette étude démontre qu'ils ont bien d'autres effets écologiques irremplaçables qui influencent le cycle des nutriments, les interactions des communautés d'espèces, la biodiversité des espèces locales et une myriade d'autres processus écologiques qui, en fin de compte, augmentent la diversité des paysages et contribuent au fonctionnement des écosystèmes. La clé ici est l'hétérogénéité spatiale du paysage créée et entretenue par les prédateurs. Elle est largement reconnue comme un facteur indispensable de nombreux processus écologiques, notamment la richesse des espèces, l'utilisation de l'espace, la dispersion, ainsi que la dynamique et la persistance des populations.
Ces différents mécanismes médiés par les prédateurs reflètent la complexité de la dynamique prédateur-proie au sein des systèmes naturels et le rôle unique qu'ils jouent dans les écosystèmes pour créer une hétérogénéité que les humains ne peuvent pas reproduire artificiellement ou avec des solutions techniques (Lennox et al. 2022).
Références bibliographiques
Adame, M. F., Fry, B., Gamboa, J. N. and Herrera-Silveira, J. A. (2015). Nutrient subsidies delivered by seabirds to mangrove islands. - Mar. Ecol. Prog. Ser. 525: 15-24.
Barceló, G., Perrig, P. L., Dharampal, P., Donadio, E., Steffan, S. A., & Pauli, J. N. (2022). More than just meat: Carcass decomposition shapes trophic identities in a terrestrial vertebrate. Functional Ecology, 36(6), 1473-1482.
Barry, J. M., Elbroch, L. M., Aiello-Lammens, M. E., Sarno, R. J., Seelye, L., Kusler, A., ... & Grigione, M. M. (2019). Pumas as ecosystem engineers: ungulate carcasses support beetle assemblages in the Greater Yellowstone Ecosystem. Oecologia, 189, 577-586.
Benkwitt, C. E., Wilson, S. K. and Graham, N. A. J. (2019). Seabird nutrient subsidies alter patterns of algal abundance and fish biomass on coral reefs following a bleaching event. - Global Change Biol. 25: 2619-2632.
Brice, E. M., Larsen, E. J. and MacNulty, D. R. 2022. Sampling bias exaggerates a textbook example of a trophic cascade. - Ecol. Lett. 25: 177-188.
Buck, J. C., Weinstein, S. B., & Young, H. S. (2018). Ecological and evolutionary consequences of parasite avoidance. Trends in ecology & evolution, 33(8), 619-632.
Danell, K., Berteaux, D. and Brathen, K. A. (2002). Effect of muskox carcasses on nitrogen concentration in tundra vegetation. - Arctic 55: 389-392
Fedriani, J. M., Garrote, P. J., Delgado, M. D. M., & Penteriani, V. (2015). Subtle gardeners: inland predators enrich local topsoils and enhance plant growth. PloS one, 10(9), e0138273.
Gable, T. D., Johnson-Bice, S. M., Homkes, A. T., Windels, S. K., & Bump, J. K. (2020). Outsized effect of predation: Wolves alter wetland creation and recolonization by killing ecosystem engineers. Science Advances, 6(46), eabc5439.
Herbert, D. A. and Fourqurean, J. W. (2008). Ecosystem structure and function still altered two decades after short-term fertilization of a seagrass meadow. - Ecosystems 11: 688-700.
Johnson-Bice, S. M., Gable, T. D., Windels, S. K. and Host, G. E. 2022. Relics of beavers past: time and population density drive scale-dependent patterns of ecosystem engineering. - Ecography 2022: e05814.
Johnson-Bice, S. M., Gable, T. D., Roth, J. D., & Bump, J. K. (2023). Patchy indirect effects of predation: predators contribute to landscape heterogeneity and ecosystem function via localized pathways. Oikos, 2023(10), e10065.
Jones, C. G., Lawton, J. H. and Shachak, M. (1994). Organisms as ecosystem engineers. - Oikos 69: 373-386.
Lang, J. A., Roth, J. D. and Markham, J. H. (2021). Foxes fertilize the subarctic forest and modify vegetation through denning. - Sci. Rep. 11: 3031.
Lennox, R. J., Brownscombe, J. W., Darimont, C., Horodysky, A., Levi, T., Raby, G. D. and Cooke, S. J. 2022. The roles of humans and apex predators in sustaining ecosystem structure and function: contrast, complementarity and coexistence. - People Nat. 4: 1071-1082.
Lorrain, A., Houlbrèque, F., Benzoni, F., Barjon, L., Tremblay-Boyer, L., Menkes, C., Gillikin, D. P., Payri, C., Jourdan, H., Boussarie, G., Verheyden, A. and Vidal, E. (2017). Seabirds supply nitrogen to reef-building corals on remote Pacific islets. - Sci. Rep. 7: 3721.
McLoughlin, P. D., Lysak, K., Debeffe, L., Perry, T. and Hobson, K. A. (2016). Density-dependent resource selection by a terrestrial herbivore in response to sea-to-land nutrient transfer by seals. - Ecology 97: 1929-1937.
Monk, J. D., & Schmitz, O. J. (2022). Landscapes shaped from the top down: predicting cascading predator effects on spatial biogeochemistry. Oikos, 2022(5), e08554.
Monk, J., Donadio, E., Gregorio, P. and Schmitz, O. (2023). Vicuña antipredator diel migration drives spatial nutrient subsidies in a high Andean ecosystem. - EcoEvoRxiv.
Navarro C. et Plancke M. (2024) Les loups rendent les routes plus sûres, permettant d'importants bénéfices économiques. FRB https://www.fondationbiodiversite.fr/les-loups-rendent-les-routes-plus-sures-ce-qui-genere-dimportants-benefices-economiques/
Peziol, M., Elbroch, L. M., Shipley, L. A., Evans, R. D., & Thornton, D. H. (2023). Large carnivore foraging contributes to heterogeneity in nutrient cycling. Landscape Ecology, 38(6), 1497-1509.
Ruprecht, J., Eriksson, C. E., Forrester, T. D., Spitz, D. B., Clark, D. A., Wisdom, M. J., ... & Levi, T. (2021). Variable strategies to solve risk-reward tradeoffs in carnivore communities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(35), e2101614118.
Shantz, A. A., Ladd, M. C., Schrack, E. and Burkepile, D. E. (2015). Fish-derived nutrient hotspots shape coral reef benthic communities. - Ecol. Appl. 25: 2142-2152.
Soubelet, H. (2017). Renard et risque de transmission de la maladie de Lyme : un effet en cascade, FRB, https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/06/FRB-Synthese-Renards-risque-transmission-maladie-Lyme.pdf
Terborgh, J., Lopez, L., Balbas, L., Nuñez V, P., Rao, M., Shahabuddin, G., Orihuela, G., Riveros, M., Ascanio, R., Adler, G. H. and Lambert, T. D. 2001. Ecological meltdown in predator-free forest fragments. - Science 294: 1923-1926.
Teurlings, I. J. M., Melis, C., Skarpe, C. and Linnell, J. D. C. (2020). Lack of cascading effects of Eurasian lynx predation on roe deer to soil and plant nutrients. - Diversity 12: 352.
Totterdell, J. A., Wellard, R., Reeves, I. M., Elsdon, B., Markovic, P., Yoshida, M., Fairchild, A., Sharp, G. and Pitman, R. L. (2022). The first three records of killer whales (Orcinus orca) killing and eating blue whales (Balaenoptera musculus). - Mar. Mamm. Sci. 38: 12906.
Weinstein, S. B., Moura, C. W., Mendez, J. F. and Lafferty, K. D. (2018). Fear of feces? Tradeoffs between disease risk and foraging drive animal activity around raccoon latrines. - Oikos 127: 927-934.
Zhao, S.-T., Johnson-Bice, S. M. and Roth, J. D. (2022). Foxes engineer hotspots of wildlife activity on the nutrient-limited Arctic tundra. - Global Ecol. Conserv. 40: e02310.